CAN/CGSB-32.310 2020
Rectificatif no 1, mars 2021
Systèmes de production biologique
Principes généraux et normes de gestion

Remplace CAN/CGSB-32.310-2015
Incorpore le modificatif no 1
Classification internationale pour les normes (ICS) 67.040 / 67.120.30
Publié par l'Office des normes générales du Canada
À propos de la norme
La présente norme est une Norme nationale du Canada sur les aliments biologiques. Elle renferme des termes techniques et spécialisés.
This National Standard of Canada is available in both English and French.
Avis de droit d’auteur
Publiée, décembre 2020, par l’Office des normes générales du Canada, Gatineau, Canada K1A 0S5
©Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, la ministre responsable de l’Office des normes générales du Canada (2021).
Avant-propos
Énoncé de l’Office des normes générales du Canada
La présente norme a été élaborée sous les auspices de l’Office des Normes Générales du Canada (ONGC), qui est un organisme relevant de Services publics et Approvisionnement Canada. L’ONGC participe à la production de normes facultatives dans une gamme étendue de domaines, par l’entremise de ses comités des normes qui se prononcent par consensus. Les comités des normes sont composés de représentants des groupes intéressés, notamment les producteurs, les consommateurs et autres utilisateurs, les détaillants, les gouvernements, les institutions d’enseignement, les associations techniques, professionnelles et commerciales ainsi que les organismes de recherche et d’essai. Chaque norme est élaborée avec l’accord de tous les représentants.
Le Conseil canadien des normes a conféré à l’ONGC le titre d’organisme d’élaboration de normes national. En conséquence, les normes que l’Office élabore et soumet à titre de Normes nationales du Canada se conforment aux exigences et lignes directrices établies à cette fin par le Conseil canadien des normes. Outre la publication de normes nationales, l’ONGC rédige également des normes visant des besoins particuliers, à la demande de plusieurs organismes tant du secteur privé que du secteur public. Les normes de l’ONGC et les normes nationales de l’ONGC sont élaborées conformément aux politiques énoncées dans le Manuel des politiques et des procédures pour l’élaboration et le maintien des normes de l’ONGC.
Étant donné l’évolution technique, les normes de l’ONGC font l’objet de révisions périodiques. L’ONGC entreprendra le réexamen de la présente norme et la publiera dans un délai qui n’excédera pas cinq ans suivant la date de publication. Toutes les suggestions susceptibles d’en améliorer la teneur sont accueillies avec grand intérêt et portées à l’attention des comités des normes concernés. Les changements apportés aux normes font l’objet de modificatifs distincts, de normes modifiées ou sont incorporés dans les nouvelles éditions des normes.
Une liste à jour des normes de l’ONGC comprenant des renseignements sur les normes récentes et les derniers modificatifs parus, figure au Catalogue de l’ONGC disponible sur notre site Web Office des Normes Générales du Canada ainsi que des renseignements supplémentaires sur les produits et les services de l’ONGC.
Même si l’objet de la présente norme précise l’application première que l’on peut en faire, il faut cependant remarquer qu’il incombe à l’utilisateur, au tout premier chef, de décider si la norme peut servir aux fins qu’il envisage.
La mise à l’essai et l’évaluation d’un produit ou service en regard de la présente norme peuvent nécessiter l’emploi de matériaux et/ou d’équipement susceptibles d’être dangereux. Le présent document n’entend pas traiter de tous les aspects liés à la sécurité de son utilisation. Il appartient à l’usager de la norme de se renseigner auprès des autorités compétentes et d’adopter des pratiques de santé et de sécurité conformes aux règlements applicables avant de l’utiliser. L’ONGC n’assume ni n’accepte aucune responsabilité pour les blessures ou les dommages qui pourraient survenir pendant les essais, peu importe l’endroit où ceux-ci sont effectués. Il faut noter qu’il est possible que certains éléments de la présente norme soient assujettis à des droits conférés à un brevet. L’ONGC ne peut être tenu responsable de nommer un ou tous les droits conférés à un brevet. Les utilisateurs de la norme sont informés de façon personnelle qu’il leur revient entièrement de déterminer la validité des droits conférés à un brevet.
Dans la présente Norme, le verbe « doit » indique une exigence obligatoire, le verbe « devrait » exprime une recommandation et le verbe « peut » exprime une option ou une permission. Les notes accompagnant les articles ne renferment aucune exigence ni recommandation. Elles servent à séparer du texte les explications ou les renseignements qui ne font pas proprement partie du corps de la norme. Les annexes sont désignées comme normative (obligatoire) ou informative (non obligatoire) pour en préciser l’application.
À des fins d’application, les normes sont considérées comme étant publiées la dernière journée du mois de leur date de publication.
Communiquez avec l’Office des normes générales du Canada
- sur le Web
- Office des Normes Générales du Canada
- par courriel
- ncr.cgsb-ongc@tpsgc-pwgsc.gc.ca
- par téléphone
- 1‑800‑665‑2472
- par la poste
- Office des normes générales du Canada Gatineau, Canada K1A 1G6
Énoncé du Conseil canadien des normes
Une Norme nationale du Canada est une norme qui a été élaborée par un organisme d’élaboration de normes (OEN) titulaire de l’accréditation du Conseil canadien des normes (CCN) conformément aux exigences et lignes directrices du CCN. On trouvera des renseignements supplémentaires sur les Normes nationales du Canada.
Le CCN est une société d’État qui fait partie du portefeuille d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE). Dans le but d’améliorer la compétitivité économique du Canada et le bien-être collectif de la population canadienne, l’organisme dirige et facilite l’élaboration et l’utilisation des normes nationales et internationales. Le CCN coordonne aussi la participation du Canada à l’élaboration des normes et définit des stratégies pour promouvoir les efforts de normalisation canadiens.
En outre, il fournit des services d’accréditation à différents clients, parmi lesquels des organismes de certification de produits, des laboratoires d’essais et des organismes d’élaboration de normes. On trouvera la liste des programmes du CCN et des organismes titulaires de son accréditation dans le site des Normes nationales du Canada.
Office des normes générales du Canada Comité sur l’agriculture biologique
Membres votants à la date d’approbation
Président (votant)
Martin, H.
Expert-conseil indépendant (intérêt général)
Catégorie intérêt général
Boudreau, N.
Fédération biologique du Canada
Eisen, R.
Expert-conseil indépendant
Gibson, J.
Manitoba Organic Alliance
Gravel, F.
Table Filière Biologique du Québec
Hamilton, R.
Organic Alberta
Hammermeister, A.
Centre d’agriculture biologique du Canada, Université Dalhousie
Jacques, S.
Le Conseil biologique de l’Ontario
Jones, S.
Atlantic Canadian Organic Regional Network
Labelle, F.
Lactanet, Le réseau canadien pour l’excellence laitière
Squires, A.
SaskOrganics Association Inc.
Street, B.
British Columbia Society for the Prevention of Cruelty to Animals Certification Division
Wallace, J.
Cultivons biologique Canada
Catégorie producteur
Bennett, N.
Ontario Greenhouse Vegetable Growers
Blackman, S.
Association canadienne de la distribution de fruits et légumes
Champagne, H.
Union des producteurs agricoles
Duval, J.
Club Bio+
Dyck, M.
Conseil canadien d’horticulture
Edwards, L.
British Columbia Organic Tree Fruit Association
Falck, D.
Small Scale Food Producers Association
Jorgens, A.
Les Compagnies Loblaw Limitée
Lefebvre, S.
Les Producteurs d’œufs du Canada
Loftsgard, T.
Association pour le commerce des produits biologiques
Murchison, K.
Prince Edward Island Certified Organic Producers Co-Operative
Perreault, G. Producteurs laitiers du Canada
Rundle, T.
Pacific Organic Seafood Association
Scheffel, M.
Association canadienne des producteurs de semences
St-Onge, A.
Producteurs et productrices acéricoles du Québec
Catégorie organisme de réglementation
Hurteau, M.-C.
Agence canadienne d’inspection des aliments
Turgeon, N.
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
Catégorie utilisateur
Hillard, J.
Consumer Interest Alliance
Kehler, C.
Herb, Spice and Specialty Agriculture Association of Saskatchewan
Monaghan, K.
International Organic Inspectors Association
Mussar, K.
Association canadienne des importateurs et exportateurs
Yasmeen, G.
Réseau pour une alimentation durable
Gestionnaire du comité (non votant)
Schuessler, M.
Office des normes générales du Canada
Nous remercions le Bureau de la traduction de Services publics et Approvisionnement Canada de la traduction de la présente Norme nationale du Canada.
Préface
La présente Norme nationale du Canada CAN/CGSB-32.310-2020 remplace l’édition de 2015 et le modificatif de 2018. En mars 2021, un rectificatif a été publié et incorporé à l’édition de décembre 2020 de la présente norme. Les modifications ci-dessous ont été apportées au document.
Changements depuis l’édition précédente
- Précisions apportées à l’objet du document
- Ajouts et révisions de définition
- Ajouts, suppressions et modifications dans les articles suivants : Plan de production biologique; Productions végétales; Production d’animaux d’élevage; Exigences propres à certaines productions (en particulier, Apiculture, Produits de l'érable, Production de germinations, de pousses et de micro-verdurettes, et Cultures produites sous des structures ou en contenants [anciennement « cultures en serre »]); Maintien de l'intégrité biologique pendant le nettoyage, la préparation et le transport, et Composition des produits biologiques
- Ajout d’une annexe informative présentant un diagramme de flux du processus décisionnel lié aux substances permises
Rectificatif
Suppression de la mention « sur les surfaces » en 8.2.1 b
Sur cette page
- Introduction
- 1 Objet
- 2 Références normatives
- 3 Termes et définitions
- 4 Plan de production biologique
- 5 Productions végétales
- 5.1 Exigences relatives aux terres utilisées en culture biologique
- 5.2 Facteurs environnementaux
- 5.3 Semences et matériel de reproduction végétale
- 5.4 Gestion de la fertilité du sol et des nutriments
- 5.5 Gestion des déjections animales
- 5.6 Lutte contre les organismes nuisibles les maladies et les mauvaises herbes
- 5.7 Irrigation
- 5.8 Préparation des produits culturaux
- 5.9 Gestion des organismes nuisibles en installations
- 6 Production d'animaux d'élevage
- 6.1 Généralités
- 6.2 Origine des animaux d'élevage
- 6.3 Conversion des unités de production d'animaux d'élevage à la production biologique (excepté les volailles visées par 6.13.1.c.1)
- 6.4 Aliments des animaux d'élevage
- 6.5 Transport et manutention
- 6.6 Soins de santé des animaux d'élevage
- 6.7 Conditions d'élevage
- 6.8 Gestion des déjections animales
- 6.9 Préparation des produits des animaux d'élevage biologiques
- 6.10 Lutte contre les organismes nuisibles
- 6.11 Exigences supplémentaires pour les bovins, les moutons et les chèvres
- 6.12 Exigences supplémentaires pour le logement des bovins laitiers
- 6.13 Exigences supplémentaires pour l'élevage de volaille
- 6.14 Exigences supplémentaires pour les lapins
- 6.15 Exigences supplémentaires pour les porcs et sangliers élevés à la ferme
- 7 Exigences propres à certaines productions
- 7.1 Apiculture
- 7.2 Produits de l'érable
- 7.3 Production de champignons
- 7.4 Production des produits dérivés des germinations, pousses et microverdurettes
- 7.5 Cultures protégées par des structures et cultures en contenants (appelées aussi cultures en serre)
- 7.6 Cueillette de plantes sauvages
- 7.7 Insectes biologiques
- 8 Maintien de l'intégrité biologique durant le nettoyage, la préparation et le transport
- 9 Composition des produits biologiques
- 10 Procédures, critères et conditions de modification de la norme CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique – Listes des substances permises
- Annexe A (informative) Classification des produits biologiques
- Annexe B (informative) Principes de la production biologique dans l'histoire
- Annexe C (informative) Notes sur les principes biologiques
- Bibliographie
Introduction
Description
La production biologique est un système de gestion holistique qui vise à maximiser la productivité et à favoriser la santé des diverses communautés de l’agroécosystème, notamment les organismes du sol, les végétaux, les animaux et les êtres humains. Le but premier de la production biologique est de développer des exploitations durables et respectueuses de l’environnement.
CAN/CGSB-32.310, Systèmes de production biologique – Principes généraux et normes de gestion, décrit les principes et les normes de gestion des systèmes de production biologique.
CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique – Listes des substances permises (LSP), fournit des listes de substances dont l’utilisation est autorisée dans les systèmes de production biologique.
Comme dans le cas de tous les produits vendus au Canada, les intrants servant à la production biologique, qui comprennent, sans toutefois s’y limiter, les engrais, les suppléments pour animaux, les pesticides, les amendements du sol, les traitements vétérinaires, les auxiliaires ou additifs à la transformation, les agents de nettoyage ou d’assainissement; et les produits dérivés de l’agriculture biologique, tels que, sans s’y limiter, les aliments pour animaux et pour consommation humaine, devraient être conformes à toutes les exigences réglementaires applicables.
Principes généraux de la production biologique
L’agriculture biologique est basée sur les principes généraux suivantsNote de bas de page 1,Note de bas de page 2.
Le principe de santé – L’agriculture biologique devrait soutenir et améliorer la santé des sols, des plantes, des animaux, des hommes et de la planète, comme étant une et indivisible.
Le principe d’écologie – L’agriculture biologique devrait être basée sur les cycles et les systèmes écologiques vivants, s’accorder avec eux, les imiter et les aider à se maintenir.
Le principe de précaution – L’agriculture biologique devrait être conduite de manière prudente et responsable afin de protéger la santé et le bien-être des générations actuelles et futures ainsi que l’environnement.
Le principe d’équité – L’agriculture biologique devrait se construire sur des relations qui assurent l’équité par rapport à l’environnement commun et aux opportunités de la vie.
Pratiques de la production biologique
Ni la présente normeNote de bas de page 3 ni les produits biologiques conformes à la présente norme ne constituent des allégations particulières quant à la santé, à la sécurité ou à la valeur nutritive de ces produits.
Les méthodes de gestion sont choisies avec soin afin de restaurer, puis de conserver la stabilité écologique au sein de l’exploitation et dans l’environnement avoisinant. La fertilité du sol est maintenue et améliorée en favorisant l’optimisation de l’activité biologique dans le sol ainsi que la conservation des ressources pédologiques. La lutte contre les ravageurs, incluant les mauvaises herbes, les insectes et les maladies s’effectue à l’aide de méthodes de contrôle biologiques et mécaniques, et de pratiques culturales qui comprennent le travail minimal du sol, le choix et la rotation des cultures, le recyclage des résidus végétaux et animaux, la gestion de l’eau, la hausse du nombre d’insectes utiles afin d’instaurer un équilibre prédateur-proie, la promotion de la diversité biologique et la lutte écologique contre les organismes nuisibles.
Dans un système de production biologique, on fournit aux animaux d’élevage l’espace et les conditions d’élevage appropriés à leurs besoins comportementaux, ainsi que des aliments biologiques. Ces pratiques visent à minimiser le niveau de stress, à favoriser une bonne santé et à prévenir les maladies.
Les produits biologiques sont obtenus et transformés dans le cadre d’un système qui vise à préserver l’intégrité des principes de la présente norme.
Les pratiques de la production biologique ainsi que la présente norme ne peuvent garantir que les produits biologiques sont totalement exempts de contaminants et de résidus de substances interdites par la présente norme, puisque l’exposition à ces composés en provenance de l’atmosphère, du sol, de l’eau souterraine et d’autres sources peut avoir lieu indépendamment de la volonté de l’exploitant. Les pratiques autorisées par la présente norme visent à assurer la présence de ces résidus à des teneurs les plus basses possible.
Durant l’élaboration de la présente norme, il a été reconnu que les différences entre les régions agricoles du Canada requièrent des pratiques différentes afin de répondre aux besoins en matière de production.
La présente norme s’inscrit dans un cadre réglementaire et de certification mis en place afin de prévenir les pratiques commerciales frauduleuses. Le processus de certification évalue la conformité des activités. La certification est accordée aux produits conformes. Les organismes de certification doivent accorder au demandeur un délai allant jusqu'à 12 mois après la date de publication d'une modification à la présente norme et à CAN/CGSB-32.311 pour qu'il puisse s'y conformer.
Notes et exemples dans cette norme
Dans la présente norme, les notes et les exemples sont utilisés afin de fournir des renseignements additionnels permettant de mieux comprendre ou d’utiliser le document et ne constituent pas une partie normative de la norme.
1 Objet
1.1 La présente Norme nationale du Canada s’applique aux produits biologiques suivants
- les végétaux et les produits végétaux, les animaux d’élevage et les produits d’animaux d’élevage non transformés, dans la mesure où les principes de production et les règles de vérification spécifiques les concernant sont décrits dans la présente norme;
- les produits transformés issus des cultures et des animaux d’élevage destinés à l’utilisation ou à la consommation humaine, et dérivés des produits mentionnés en 1.1 a;
- les aliments pour animaux d’élevage;
- les produits transformés issus des cultures et des animaux d’élevage destinés à l’utilisation et à la consommation animale et dérivés des produits mentionnés en 1.1 a.
1.2 Les produits dont il est question dans cette norme proviennent d’un système de production qui
- cherche à maintenir des écosystèmes par ses pratiques de gestion en visant l’atteinte d’une productivité durable;
- lutte contre les ravageurs, incluant les insectes, les mauvaises herbes et les maladies grâce à l’amélioration de la biodiversité, au recyclage des résidus des végétaux et animaux, à la sélection et à la rotation des cultures, à la gestion des eaux, au travail du sol et aux méthodes culturales.
1.3 Unités de mesure
Dans la présente norme, les valeurs et les dimensions sont exprimées en unités métriques tandis que les équivalents en unités impériales, dont la plupart ont été obtenus par conversion arithmétique, sont indiqués entre parenthèses. Les unités métriques feront foi en cas de litige ou de difficultés imprévues résultant de la conversion.
1.4 Matériaux ou techniques interdits dans la production et la préparation des produits biologiques
Pour produire ou préparer des produits biologiques, les matériaux ou techniques qui suivent sont interdits puisqu’ils sont incompatibles avec les principes généraux de production biologique :
- tous les produits obtenus par génie génétique, tels qu’ils sont définis dans la présente norme, et précisés en 4.1.3, 5.1.2 et 6.2.1 de 32-311 de la norme CAN/CGSB-32.311;
- tous les produits, matériaux ou procédés obtenus par la nanotechnologie, tel que défini dans la présente norme, à l’exception des :
- particules naturelles de taille nanométrique, ou celles qui sont produites accidentellement par le biais de processus normaux tels que la mouture des grains;
- surfaces de contact, comme celles de l’équipement, surfaces de travail ou matériaux d’emballage, lorsque le transfert de particules de taille nanométrique vers les cultures, les animaux d’élevage ou les substances biologiques est imprévu et peu probable;
- l’irradiation telle qu’elle est définie dans la présente norme, pour le traitement des produits biologiques et intrants utilisés dans la production de produits biologiques, sous réserve des dispositions prévues dans CAN/CGSB-32.311;
- les animaux d’élevage clonés et leurs descendants;
- l’équipement, les conteneurs de récolte et d’entreposage, les installations d’entreposage et les matériaux de conditionnement traités avec des fongicides, agents de conservation ou de fumigation et pesticides non répertoriés dans la norme CAN/CGSB-32.311, sauf dans les cas prévus aux articles 8.2.3 et 8.3.3 de CAN/CGSB-32.310.
1.5 Substances interdites dans la production et la préparation de produits biologiques
En plus de 1.4, pour produire ou préparer des produits biologiques, les substances qui suivent sont interdites puisqu’elles sont incompatibles avec les principes généraux de la production biologique :
- les amendements du sol, comme les engrais ou les matières d’origine végétale et animale compostées, qui renferment une substance ne figurant pas dans la norme CAN/CGSB-32.311;
- les boues d’épuration;
- les auxiliaires de production végétale ou substances non répertoriés dans la norme CAN/CGSB-32.311;
- les régulateurs de croissance d’origine végétale, fongique ou animale, excepté ceux spécifiquement permis par la norme CAN/CGSB-32.311;
- les médicaments d’usage vétérinaire, y compris les antibiotiques et les parasiticides, sous réserve des dispositions prévues dans la présente norme;
- les ingrédients non biologiques, les additifs alimentaires et les auxiliaires de production, y compris les sulfates, les sulfites, les nitrates et les nitrites, utilisés dans la préparation de produits biologiques, sous réserve des dispositions prévues dans la présente norme ou spécifiées dans la norme CAN/CGSB-32.311;
- les produits de formulation sauf ceux spécifiés dans la norme CAN/CGSB-32.311.
Remarque
Voir l’arbre de décision des LSP à l’annexe B pour consulter une méthode d’évaluation de la conformité des intrants.
2 Références normatives
Les documents normatifs suivants renferment des dispositions qui, par renvoi dans le présent document, constituent des dispositions de la présente Norme nationale du Canada. Les documents de référence peuvent être obtenus auprès des sources mentionnées ci-après.
Remarque
Les adresses indiquées ci-dessous étaient valides à la date de publication de la présente norme.
Sauf indication contraire de l’autorité appliquant la présente norme, toute référence non datée s’entend de l’édition ou de la révision la plus récente de la référence ou du document en question. Une référence datée s’entend de la révision ou de l’édition précisée de la référence ou du document en question.
2.1 Office des normes générales du Canada
CAN/CGSB-32.311 – Systèmes de production biologique – Listes des substances permises.
CAN/CGSB-32.312 – Systèmes de production biologique : Aquaculture – Principes généraux, normes de gestion et listes des substances permises
2.1.1 Source
Les publications susmentionnées peuvent être obtenues auprès de l’Office des normes générales du Canada (ONGC).
Centre des ventes
Gatineau, Canada K1A 1G6
- Téléphone :
- 819‑956‑0425 ou 1‑800‑665‑2472
- Télécopieur :
- 819‑956‑5740
- Courriel :
- ncr.cgsb-ongc@tpsgc-pwgsc.gc.ca
- Site Web :
- Office des normes générales du Canada
2.2 Agence canadienne d’inspection des aliments
- Loi sur la salubrité des aliments au Canada (L.C, 2012, ch. 24)
- Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (DORS/2018-108), partie 13.
2.2.1 Source
Les lois et règlements susmentionnés peuvent être obtenus auprès de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) à Agence canadienne d'inspection des aliments ou sur le Site Web de la législation (Justice).
2.3 IFOAM Organics International
Principes de l’agriculture biologique.
2.3.1 Source
Les principes susmentionnés peuvent être obtenus du site IFOAM à IFOAM Organics International (disponible en anglais seulement).
2.4 Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage
- En cas de conflit ou de divergence entre la présente norme et l’un des codes de pratique ci-dessous, la présente norme aura préséance :
- Code de pratiques pour le soin et la manipulation des bovins laitiers
- Code de pratiques pour le soin et la manipulation des bovins de boucherie
- Code de pratiques pour le soin et la manipulation des veaux lourds
- Code de pratiques pour le soin et la manipulation des porcs
- Code de pratiques recommandées pour le soin et la manipulation des animaux de ferme – Transport.
- Code de pratiques pour le soin et la manipulation des poulettes et pondeuses
- Code de pratiques pour le soin et la manipulation des oeufs d’incubation, des reproducteurs, des poulets et des dindons
- Code de pratiques pour le soin et la manipulation des moutons
- Code de pratiques pour le soin et la manipulation des chèvres
- Code de pratiques pour le soin et la manipulation des lapins
- Code de pratiques pour le soin et la manipulation des bisons
2.4.1 Source
Les publications susmentionnées peuvent être obtenues du site Web du Codes de pratiques pour les soins et la manipulation des animaux d’élevage (CNSAE).
3 Termes et définitions
Pour les besoins de la présente Norme nationale du Canada, les termes et définitions suivants s’appliquent.
- 3.1 aéroponie (aeroponics)
- méthode de culture qui ne requiert pas de sol et dans laquelle les végétaux sont suspendus, leurs racines étant exposées à l’air.
- 3.2 agricole (agricultural)
- relatif à la production végétale et à l’élevage ainsi qu’à tout produit qui en résulte..
- 3.3 agro-écosystème (agro-ecosystem)
- système composé de la forme, de la fonction, de l’interaction et de l’équilibre des éléments biotiques et abiotiques présents dans l’environnement d’une exploitation agricole donnée.
- 3.4 allopathique (allopathic)
- relatif à l’allopathie.
- 3.5 allopathie (allopathy)
- méthode de traitement d’une maladie par des substances qui produisent une réaction ou des effets différents de ceux de la maladie.
- 3.6 semis annuel (annual seedling)
- jeune plante cultivée à partir de la graine qui complétera son cycle de vie ou produira une récolte durant la même campagne agricole ou la même saison que celle où elle a été plantée.
- 3.7 antibiotique (antibiotic)
- toute drogue ou tout mélange de drogues, lesquels sont préparés à partir de certains microorganismes, ou l'ont été antérieurement, mais sont maintenant fabriqués synthétiquement, et sont doués de propriétés inhibitrices de la croissance d'autres microorganismes, y compris les champignons, bactéries et virus.
- 3.8 apiculture (apiculture)
- gestion et production de reines et d’abeilles mellifères et de leurs produits (comme le miel, la cire d’abeille, le pollen, la gelée royale, la propolis et le venin d’abeille).
- 3.9 litière (bedding)
- matériau, comme la paille hachée ou les copeaux de bois, ajouté à l’environnement d’hébergement des animaux dans le but d’ajouter du confort et d’encourager les comportements naturels.
- 3.10 biosourcé (biobased)
- qualité d’une substance dérivée de source végétale, animale ou microbienne.
- 3.11 biodégradable (biodegradable)
- intrants ou auxiliaires utilisés en production végétale et d’animaux d’élevage pouvant être décomposés par l’action de micro-organismes à l’intérieur de 24 mois dans le sol (à l’exception de la biomasse végétale), d’un mois en milieu aqueux aérobique, et de deux mois en milieu aqueux anaérobique, avec un impact environnemental minimal.
- 3.12 organique (biological)
- relatif aux organismes multicellulaires ou unicellulaires (ou leurs composantes) comme les animaux, les plantes, les champignons, les bactéries, les protéines, les acides nucléiques et les virus, etc.
- 3.13 zone tampon (buffer zone)
- zone limitrophe clairement définie et reconnaissable séparant une unité de production biologique de zones adjacentes non biologiques.
- 3.14 glucides (carbohydrate)
- sucre ou composé d'amidon, tel que le dextrose (glucose).
- 3.15 animaux clonés (cloned animals)
- animaux identiques obtenus de manière assistée à partir de la manipulation et du transfert d’embryons, en utilisant des techniques telles que le transfert de noyaux de cellules somatiques, le transfert de noyaux de cellules embryonnaires ou la segmentation d’embryons.
- 3.16 colonie (colony)
- groupe d’abeilles comprenant normalement plusieurs milliers d’ouvrières, des faux-bourdons (mâles) et une reine formant une unité sociale dans une ruche ou un autre abri.
- 3.17 disponible sur le marché (commercially available)
- capacité d’obtenir, pièces à l’appui, un ingrédient ou un intrant d’une forme, qualité, quantité ou variété appropriées, sans égard au coût, pour remplir une fonction essentielle en production ou préparation de produits biologiques.
- 3.18 mélange (commingling)
- mélange ou contact physique entre des produits biologiques et non biologiques en vrac, non liés ou non emballés au cours de la production, de la préparation, du transport, ou de l’entreposage.
- 3.19 compost (compost)
- produit dérivé d’un processus aérobie supervisé sous lequel des micro-organismes digèrent des matières organiques.
- 3.20 thé de compost (compost tea)
- substance liquide obtenue par le trempage d’un compost stable dans l’eau et qui favorise la croissance des microorganismes bénéfiques
- 3.21 rotation des cultures (crop rotation)
- alternance de cultures dans un champ donné et selon une séquence prévue, au cours de campagnes agricoles successives, de sorte que des plantes de la même espèce ou de la même famille ne soient pas cultivées de façon continue dans le même champ. La culture en bande, les cultures intercalaires et les haies sont employées comme techniques au lieu de la rotation dans les systèmes de culture de vivaces, pour introduire de la diversité biologique.
- 3.22 dérivé (derivative)
- substance créée par la modification moléculaire d'une autre substance (la source) habituellement par substitution chimique ou réaction supplémentaire.
- 3.23 additif pour alimentation animale (feed additive)
- substance ajoutée à un aliment pour animaux en petite quantité pour combler un besoin nutritionnel particulier, par exemple des substances nutritives essentielles sous la forme d’acides aminés, de vitamines et de minéraux, et des additifs non nutritifs tels des agents anti-agglomérants et antioxydants.
- 3.24 supplément alimentaire (feed supplement)
-
désigne un aliment utilisé avec un autre en vue d’améliorer la valeur nutritive totale de l’aliment et destiné à être :
- servi sous forme concentrée comme complément à d’autres aliments;
- disponible séparément et servi en libre choix avec d’autres éléments de la ration; ou
- dilué et mélangé de nouveau pour donner un aliment complet.
Remarque
Au Canada, la Loi relative aux aliments du bétail exige que l’aliment qui en résulte soit admissible à l’enregistrement.
- 3.25 fermentation (fermentation)
- transformation d'un glucide en composés plus simples ou plus complexes par une enzyme ou des enzymes produites par des micro-organismes. Par exemple, les sucres peuvent être fermentés en présence de levure pour produire de l'alcool ou de l'acide acétique avec du dioxyde de carbone. La fermentation suivie de l'extraction et de la purification peut isoler la substance des autres produits et des impuretés du procédé de fermentation; elle peut être utilisée pour produire des composés tels que des enzymes, des antibiotiques, des acides aminés et des acides organiques (citrique, gibbérellique, lactique). Aussi connu sous le nom de fermentation microbienne ou biofermentation.
- 3.26 engrais (fertilizer)
- substance simple ou mélangée constituée d’un ou de plusieurs éléments nutritifs reconnus pour les végétaux.
- 3.27 filtrat (filtrate)
- liquide qui passe dans un filtre à osmose dans la production du sirop d’érable ou du sirop provenant de la sève d’un autre arbre.
- 3.28 additif alimentaire (food additive)
- même signification que dans l’article B.01.001 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues.
- 3.29 qualité ou grade alimentaire (food-grade)
- désignation utilisée pour indiquer qu’une substance (par exemple, un matériel de nettoyage, un gaz, etc.) ou un objet/équipement (par exemple, un comptoir, des récipients, un convoyeur, etc.) peut entrer en contact avec des aliments ou des surfaces en contact avec des aliments, ou est sans danger pour la consommation humaine.
- 3.30 fourrage (forage)
- substance végétale fraîche, séchée ou ensilée (pâturage, foin ou ensilage) utilisée pour l’alimentation des animaux.
- 3.31 génie génétique (genetic engineering) également connu comme le domaine scientifique et biotechnologique qui crée les organismes génétiquement modifiés (OGM)
-
manipulation artificielle de cellules vivantes dans le but de modifier leur génome le génie génétique regroupe un ensemble de techniques de la biotechnologie moderne qui modifient le matériel génétique d’un organisme autrement que par sélection génétique traditionnelle utilisant la multiplication ou la recombinaison naturelle. Le génome étant considéré comme une entité indivisible, l’insertion, la suppression ou la réorganisation artificielles d’éléments du génome par des moyens techniques ou physiques sont des actes de génie génétique.
Des techniques qui seront développées à l’avenir pourront être considérées comme du génie génétique. Des exemples de ces techniques employées en génie génétique comprennent, entre autres :
- les techniques d’édition de gènes ou du génome, tels que Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR), qui remplacent une séquence d’ADN par une autre ou transposent, enlèvent ou insèrent une séquence de gènes, intégralement ou en partie;
- les techniques de recombinaison de l’ADN faisant appel à des systèmes de vecteurs;
- la cisgenèse;
- l’intragenèse;
- l’agroinfiltration;
- les techniques d’introduction directe dans un organisme de matériels héréditaires préparés par un quelconque moyen à l’intérieur ou à l’extérieur de cet organisme;
- les techniques de fusion cellulaire (y compris la fusion de protoplastes) ou d’hybridation qui permettent d’éliminer les barrières naturelles liées à la physiologie, à la reproduction ou à la recombinaison, lorsque les cellules ou les protoplastes donneurs n’appartiennent pas à la même famille taxonomique ou sont créés à l’extérieur de l’organisme, voire manipulés dans l’organisme, par des technologies telle la biologie synthétique.
Sauf lorsque l’organisme donneur/receveur a été obtenu au moyen de l’une des techniques susmentionnées, les techniques non visées par la présente définition sont notamment :
- la fertilisation in vitro;
- la conjugaison, la transduction, la transformation ou tout autre processus naturel;
- l’induction polyploïdique;
- les techniques de fusion cellulaire (y compris la fusion de protoplastes) ou d’hybridation lorsque les cellules ou les protoplastes donneurs appartiennent à la même famille taxonomique et ne sont pas créés à l’extérieur de l’organisme, voire manipulés dans l’organisme, par des technologies telle la biologie synthétique.
- 3.32 herbivore (herbivore)
- animal se nourrissant principalement de plantes.
- 3.33 ruche (hive)
- structure de fabrication humaine servant d’abri aux abeilles. Voir également « matériel apicole ».
- 3.34 hydroponie (hydroponics)
- culture des végétaux avec des solutions nutritives aqueuses, sans le support d’un sol.
- 3.35 additifs indirects (incidental additives)
- substance utilisée dans les installations de transformation de produits biologiques qui peuvent se retrouver comme résidus dans les produits biologiques. Par exemple : les produits pour les mains (savons, antiseptiques, lotions, crèmes protectrices), les composés de traitement d’eau de chaudière, les composés de traitement de l’eau, les lubrifiants (agents de démoulage, solvants), les agents antimousses et les produits chimiques non alimentaires (agents d’assinissement, désinfectants, agents de nettoyage et détergents).
- 3.36 ingrédient (ingredient)
- substance, y compris un additif alimentaire, utilisée dans la fabrication ou la préparation d’un produit. Cette substance est présente dans le produit final, éventuellement sous une forme modifiée.
- 3.37 intrant (input)
- substance utilisée en production ou préparation: par exemple, les engrais, les suppléments pour animaux, les pesticides, les amendements du sol, les traitements vétérinaires, les auxiliaires de production, les agents de nettoyage ou d’assainissement.
- 3.38 irradiation (irradiation)
- désigne le traitement par rayons ionisants.
- 3.39 distance d’isolement (isolation distance)
- distance établie pour isoler une culture biologique d’une plante commercialisée du même type issue du génie génétique. La distance d’isolement est la plus courte distance entre la bordure d’une culture biologique et la bordure de la culture génétiquement modifiée du même type.
- 3.40 portée (litter)
- groupe de jeunes animaux nés en même temps d’une même mère, telle une portée de porcelets.
- 3.41 fumier (litter material)
- mélange de matériaux de litière et d’excréments d’animaux, comme des déjections animales, de la poussière et des plumes accumulées sur le plancher d’une installation d’élevage (p. ex. étable, poulailler).
- 3.42 animaux d’élevage (livestock)
- animaux élevés pour l’alimentation ou destinés à la production d’aliments, notamment les bovins, les ovins, les porcs, les chèvres, les équidés, les lagomorphes (lapins), les volailles et les abeilles. Les produits de la chasse ou de la pêche d’animaux sauvages ne font pas partie de cette définition.
- 3.43 déjections animales (manure)
- fèces, urine et autres excréments des animaux d’élevage.
- 3.44 micro-verdurettes (microgreens)
- jeunes plantes comestibles qui sont récoltées plus tard que les germinations, généralement lorsque les cotylédons sont entièrement formés ou lorsque deux ou quatre vraies feuilles sont apparues
- 3.45 nanotechnologie (nanotechnology)
- manipulation de matière à l’échelle atomique, moléculaire ou macromoléculaire variant de 1 à 100 nm afin de créer des matériaux, des appareils et des systèmes ayant des propriétés et des fonctions fondamentalement nouvelles. Les substances chimiques nanométriques, ou les nanomatériaux, ont un comportement différent de celui de leurs homologues macrométriques et affichent des propriétés mécaniques, optiques, magnétiques ou électroniques différentes.
- 3.46 plan de gestion des nutriments (nutrient management plan)
- plan d’allocation des nutriments en vertu duquel le moment de l’application et la quantité de nutriments appliquée sont déterminés par le niveau de richesse du sol (déterminé par analyses), les besoins de la culture en nutriments, le type d’amendement du sol (déjections animales, compost, engrais verts ou autres substances permises), les teneurs en nutriments des amendements et le rythme prévu de libération de ces derniers. Le but du plan est de minimiser les pertes de nutriments, de protéger la qualité de l’eau, de maintenir la fertilité du sol et d’assurer l’utilisation efficace des amendements de sol autorisés.
- 3.47 exploitation (operation)
- ferme, entreprise ou organisme qui produit ou prépare un produit biologique; une exploitation peut inclure de multiples unités de production (voir 3.62 unité de production).
- 3.48 exploitant (operator)
- personne, entreprise ou organisme qui produit, prépare, emballe ou détient une marque de commerce des produits en vue de leur vente, commerce ou commercialisation ultérieure avec la mention « biologique ».
- 3.49 intégrité biologique (organic integrity)
- maintien des qualités biologiques inhérentes à un produit, de l’étape de réception des ingrédients jusqu’au point de vente final.
- 3.50 produit biologique (organic product)
- denrée ou substance qui a été produite dans le cadre d’un système conforme à la présente norme.
- 3.51 production biologique (organic production)
- méthode de production agricole conforme à la présente norme.
- 3.52 production parallèle (parallel production)
- production ou préparation simultanée de cultures biologiques et non biologiques, incluant les cultures en conversion, les animaux d’élevage et autres produits agricoles, de variétés identiques ou semblables et visuellement impossibles à distinguer par une personne non qualifiée lorsque les cultures, animaux ou produits sont placés côte à côte.
- 3.53 antiparasitaire (parasiticide)
- substance pharmaceutique ou médicament vétérinaire, tel que les anthelminthiques (y compris les vermifuges), utilisé pour lutter contre les parasites internes ou externes en production d’animaux d’élevage.
- 3.54 culture vivace (perennial crop)
- culture, autre que biannuelle, dont les plants peuvent donner une récolte sur plus d’une campagne annuelle, ou qui ont besoin d’au moins une année après la plantation pour être récoltés.
- 3.55 organisme nuisible (pest)
- organisme constituant une nuisance pour les humains ou pour les ressources utilisées par les humains, comme certaines espèces de virus, bactéries, champignons, mauvaises herbes, parasites, arthropodes et rongeurs.
- 3.56 pesticide (pesticide)
- substance utilisée directement ou indirectement pour attirer, détruire, repousser, contrôler les organismes nuisibles ou en prévenir la présence, ou pour modifier la croissance, le développement ou les caractéristiques des mauvaises herbes. Comprend les organismes, les substances ou le mélange de substances et mécanismes comme les appâts et les pièges.
- 3.57 matériel de reproduction végétale (planting stock)
- végétal ou tissu végétal, autre que des semis annuels, utilisé pour la production ou la multiplication de végétaux. Par exemple, les rhizomes, les pousses, les boutures de feuilles ou de tiges, les racines ou les tubercules, les bulbes ou les cayeux.
- 3.58 prébiotiques (prebiotics)
- fibres alimentaires et transporteurs potentiels pour les bactéries. L’inuline, le lactulose, divers galacto-oligosaccharides, fructo-oligosaccharides et xylo-oligosaccharides, ainsi que les polyalcools, sont des exemples de prébiotiques.
- 3.59 préparation (preparation)
- dans le cas d’un produit biologique, la préparation englobe la manipulation postrécolte, la fabrication, la transformation, le traitement, la conservation et l’abattage.
- 3.60 probiotiques (probiotics)
- micro-organismes qui procurent des avantages pour la santé lorsqu’ils sont consommés.
- 3.61 auxiliaires de production (processing aids)
- substances ajoutées à un aliment pour obtenir un effet technologique au cours de la transformation et qui ne sont pas présentes dans le produit alimentaire fini, ou qui sont présentes en quantité négligeable et non fonctionnelle.
- 3.62 unité de production (production unit)
- partie identifiable d’une exploitation telle que décrite dans le plan de production biologique qui produit ou prépare un produit biologique. Par exemple, une unité de production peut être un champ dont les limites sont clairement indiquées, un pâturage, une serre ou une série de serres, ou un ou plusieurs bâtiments. Une « unité de production d’animaux d’élevage » est un troupeau d'animaux ou d'oiseaux incluant les bâtiments d’élevage utilisés tels que les granges, et les pâturages. Même si les champs ou les bâtiments ne sont pas reliés entre eux, une exploitation entière peut être considérée comme une seule unité de production si l'ensemble de l'exploitation est biologique et régie par un seul plan biologique. En cas de production fractionnée ou parallèle, les unités de production biologique doivent être suffisamment séparées des unités de production non biologique pour éviter toute contamination croisée.
- 3.63 matériaux interdits (prohibited materials)
- matériaux interdits à l’article 1.4.
- 3.64 substances interdites (prohibited substances)
- substances interdites à l’article 1.5 ou qui ne sont pas répertoriées dans la norme CAN/CGSB-32.311.
- 3.65 registres (records)
- information sous forme écrite, visuelle ou électronique qui documente les activités entreprises par un exploitant engagé dans la production ou la préparation de produits biologiques.
- 3.66 intervention subséquente (removal event)
- procédure effectuée avant chaque cycle ou charge de production pour prévenir la mise en contact des produits biologiques avec des substances interdites ou le mélange avec des produits non biologiques. Des exemples d’interventions subséquentes sont le rinçage à l’eau potable, l’égouttage ou la purge d’un système avec un produit biologique.
- 3.67 sel (salt)
- chlorure de sodium ou substituts à faible teneur en sodium ou sans sodium, qui servent à donner une saveur de sel, un contrôle nutritionnel ou microbien dans un produit. Lorsqu’utilisé pour amender le sol, le terme « sel » inclut également les chlorures de calcium et de potassium.
- 3.68 pelliculage des semences (seed coating)
- application d’une substance à la surface d'une semence pour accomplir une fonction distincte de l’enrobage.
- 3.69 enrobage des semences (seed pelleting)
- élargissement d’une semence avec des substances pour augmenter sa taille dans le but de faciliter le semis.
- 3.70 trempage des semences (seed priming)
- ajout d’une solution à base d’eau aux semences, avant le semis, afin d’améliorer l’uniformité et la vitesse de germination. Après avoir été humidifiées, les semences subissent un séchage qui permet leur expédition et leur entreposage à court terme.
- 3.71 traitement des semences (seed treatment)
- ajout de produits antiparasitaires, de régulateurs de croissance des plantes, ou d’inoculants, etc. aux semences afin d’accroître leur performance sur le terrain. Le traitement peut avoir lieu avant ou après le semis.
- 3.72 boues d’épuration (sewage sludge)
- matière solide, liquide ou semi-solide obtenue lors du traitement des eaux usées municipales ou industrielles. Les boues d’épuration comprennent, sans s’y limiter, les boues domestiques, l’écume ou les solides extraits lors des procédés de traitement primaires, secondaires ou avancés des eaux usées, ou les matières dérivées de boues d’épuration.
- 3.73 sol (soil)
- mélange de minéraux, de matières organiques et d’organismes vivants.
- 3.74 matériel à risque spécifié (MRS) (specified risk material (SRM))
- le crâne, la cervelle, les ganglions trigéminés (nerfs attachés à la cervelle), les yeux, les amygdales, la moelle épinière, les ganglions de la racine dorsale (nerfs attachés à la moelle épinière) de ruminants âgés de 30 mois ou plus, et l’iléon distal (partie du petit intestin) de ruminants de tous âges.
- 3.75 production fractionnée – exploitation fractionnée (split production – split operation)
- exploitation qui produit ou prépare des produits agricoles biologiques et non biologiques, incluant la production en conversion.
- 3.76 symbiotiques (symbiotics)
- combinaison de probiotiques et de prébiotiques. Bon nombre contiennent un probiotique cultivé sur un substrat composé d’un prébiotique qui en favorise la croissance.
- 3.77 biologie synthétique (synthetic biology)
- décrit de manière générale la conception et la fabrication de nouveaux processus biologiques artificiels, d'organismes ou de dispositifs, ou la reconception artificielle de systèmes biologiques naturels existants.
- 3.78 substance synthétique (synthetic substance)
- substance fabriquée, par exemple un produit pétrochimique, qui est formulée ou produite selon un processus chimique ou un processus qui modifie chimiquement les composés extraits de végétaux, de micro-organismes ou de source animale ou minérale. Ce terme ne s’applique pas aux composés de synthèse obtenus à l’aide de processus mécaniques ou biologiques pouvant inclure le chauffage et la transformation mécanique. Toutefois, les minéraux modifiés par des réactions chimiques causées par le chauffage ou le brûlage sont considérés comme des substances synthétiques.
- 3.79 traçabilité (traceability)
- capacité de retracer un produit en aval et en amont, au cours de tous les stades de production et de préparation.
- 3.80 sélection génétique traditionnelle (traditional breeding)
- sélection génétique basée sur la reproduction sexuée. Elle a lieu entre organismes très proches dans la taxonomie, dans les cellules reproductrices et entre chromosomes d’une même paire par recombinaison homologue.
- 3.81 période de conversion (transitional period)
- période entre le début d’un programme de gestion biologique et l’obtention du statut biologique d’une unité de production ou exploitation.
- 3.82 plant repiqué (transplant)
- plant qui a été extrait de son lieu de production d’origine, transporté puis transplanté
- 3.83 produit biologique vétérinaire (veterinary biologic)
- helminthe, protozoaire ou micro-organisme; ou substance ou mélange de substances dérivé d’animaux, d’helminthes, de protozoaires ou de micro-organismes; ou substance d’origine synthétique fabriquée, vendue ou promue pour le diagnostic, le traitement, l’atténuation ou la prévention d’une maladie, d’un trouble, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, ou pour rétablir, corriger ou modifier les fonctions biologiques des animaux. Les produits biologiques vétérinaires comprennent les vaccins, les bactérines, les bactérines anatoxines, les immunoglobulines, les trousses de diagnostic et tout produit biologique vétérinaire issu de la biotechnologie.
- 3.84 médicament vétérinaire (veterinary drug)
- substance ou mélange de substances utilisé ou administré chez les animaux soit pour le diagnostic, le traitement, l’atténuation ou la prévention d’une maladie, d’un trouble ou d’un état physique anormal ou des symptômes de ces derniers; rétablissant, corrigeant ou modifiant les fonctions biologiques des animaux.
- 3.85 plante sauvage (wild crop)
- plante prélevée ou récoltée dans son habitat naturel.
- 3.86 levure (yeast)
- micro-organismes unicellulaires qui produisent des enzymes, du dioxyde de carbone (CO2) et d’autres métabolites des glucides et dont les propriétés sont souvent exploitées en fermentation, en boulangerie, pour aromatiser les aliments ou en augmenter la valeur nutritionnelle et pour prodiguer des avantages pour la santé.
- 3.87 extraits d’autolysats de levure (yeast autolysate extract)
- composantes hydrosolubles de la levure, généralement produites par autolyse, un processus par lequel la paroi cellulaire se désintègre sous l’action d’un facteur mécanique ou chimique.
4 Plan de production biologique
4.1 L’exploitant doit préparer un plan de production biologique qui décrit de manière détaillée le processus de conversion et les pratiques de production, de préparation et de gestion.
4.2 Le plan de production biologique doit être révisé annuellement pour tenir compte des modifications apportées au plan ou au système de gestion, des problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre du plan et des mesures prises pour résoudre ces problèmes.
4.3 Le plan de production biologique doit comprendre une description du système interne de tenue des registres, avec suffisamment de documents pour répondre aux exigences relatives à la traçabilité prescrites en 4.4.2 et aux autres exigences relatives à la tenue des registres.
4.4 Tenue des registres et identification
4.4.1 L’exploitant doit tenir à jour les registres et les documents d’appui pertinents tels que des aides visuelles (par exemple, les cartes, les diagrammes de déroulement des travaux) pour décrire en détail les intrants utilisés, la production, la préparation, la manutention et le transport des cultures, des animaux d’élevage et des produits biologiques. L’exploitant est responsable du maintien de l’intégrité biologique du produit et doit consigner et déclarer l’ensemble des activités et des transactions de façon suffisamment détaillée afin de démontrer avec clarté la conformité avec la présente norme.
4.4.2 Les registres doivent permettre de retracer :
- l’origine, la nature et les quantités des produits biologiques livrées à l’unité de production ou l’exploitation;
- la nature, les quantités et les destinataires des produits ayant quitté l’unité de production;
- toute autre information, telle que l’origine, la nature et les quantités des intrants, ingrédients, additifs et auxiliaires de production livrés à l’unité de production, ainsi que la composition des produits transformés, pour permettre une vérification adéquate des opérations;
- les activités ou les procédés qui démontrent la conformité à la présente norme.
4.4.3 Un système d’identification doit être mis en place pour distinguer les cultures, les animaux d’élevage (par exemple, par l’aspect général, la couleur, la variété et le type) et les produits biologiques de ceux qui sont non biologiques.
4.4.4 L’exploitant doit concevoir et implanter un plan de gestion des risques pour prévenir la contamination par des cultures issues du génie génétique, lequel peut inclure des stratégies telles que des barrières physiques, des rangées périphériques, la pratique du semis différé, l’analyse de semences, les distances d’isolement et les protocoles de désinfection de l’entrepôt et de l’équipement.
4.4.5 Les registres doivent être conservés pendant au moins cinq ans après leur création.
4.4.6 L’exploitant doit surveiller et documenter l’utilisation d’une substance pour le contrôle des organismes nuisibles qui ne figure pas dans la norme CAN/CGSB-32.311 et qui est utilisée en vertu de tout programme gouvernemental obligatoire.
Remarque
Au Canada, advenant une épidémie de ravageurs, l’exploitant est tenu d’aviser sans délai l’organisme de certification de tout changement qui pourrait affecter le processus de certification du produit biologique.
5 Productions végétales
L’article 8.4 s’applique au transport des végétaux et des récoltes.
5.1 Exigences relatives aux terres utilisées en culture biologique
5.1.1 La présente norme doit être intégralement appliquée dans une unité de production pendant au moins 12 mois avant la première récolte biologique. Les substances interdites ne doivent pas avoir été utilisées pendant au moins 36 mois avant la récolte de toute production biologique.
5.1.2 Lors de l’ajout de nouvelles unités de production à une exploitation biologique existante, l’exploitant doit démontrer par les données consignées dans ses registres qu’aucune substance interdite n’a été utilisée pendant au moins 36 mois (voir 5.1.1); les produits issus de ces nouvelles unités de production doivent faire l’objet d’une vérification avant d’être récoltés.
Remarque
La Partie 13 – Produits biologiques du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada exige que la demande de certification biologique de végétaux cultivés en champ (grandes cultures, cultures horticoles ou pâturages) soit soumise au moins quinze mois avant la date prévue de mise en marché. Durant cette période, l’organisme de certification évaluera la conformité à la présente norme et cette évaluation doit comprendre au moins une inspection de l’unité de production dans l’année précédant l’admissibilité des végétaux cultivés en champ à la certification et une inspection dans l’année où ces mêmes végétaux sont admissibles à la certification.
5.1.3 L’exploitation doit viser une conversion complète de sa production. Pendant la période de conversion, l'exploitation peut maintenir, en plus de la production en conversion, un système de production non biologique (exploitation fractionnée) qui doit être entièrement distinct et identifié séparément jusqu'à son intégration dans le processus de conversion global.
5.1.4 L'exploitation peut être convertie à raison d'une unité à la fois. Chaque unité de production convertie doit respecter les exigences de la présente norme. L'exception à cette norme, la production parallèle, est permise uniquement dans les cas suivants :
- cultures annuelles récoltées au cours des 24 derniers mois de la période de conversion lorsque des champs sont ajoutés aux exploitations existantes;
- cultures vivaces (déjà plantées);
- installations de recherche en agriculture;
- production de semences, de matériel de multiplication végétative et de plants à repiquer.
5.1.5 La pratique de la production parallèle doit respecter les conditions particulières suivantes :
- L’exploitant doit démontrer clairement qu'il est possible de préserver l'identité des cultures ainsi produites durant leur production, leur récolte, leur entreposage, leur transformation, leur emballage et leur commercialisation;
- L’exploitant doit tenir des registres exacts et vérifiables sur les produits non biologiques et biologiques et sur leur entreposage, leur transport, leur transformation et leur commercialisation.
Remarque
Les cultures de production parallèle, tant les cultures biologiques que non biologiques, sont inspectées juste avant la récolte. Une vérification de toutes les cultures en production parallèle a lieu après la récolte.
5.1.6 Toute unité de production doit être délimitée de façon distincte et précise.
5.1.7 La régie de production ne doit pas alterner entre les modes biologique et non biologique sur une même unité de production.
5.2 Facteurs environnementaux
5.2.1 Des mesures doivent être prises pour minimiser le mouvement des substances interdites vers les cultures et terres agricoles biologiques en provenance :
- des zones avoisinantes;
- de l’équipement utilisé à la fois en production de cultures biologiques et non biologiques.
5.2.2 S’il existe des risques de contact avec des substances interdites, il est requis d’établir des zones tampons distinctes ou d’autres barrières physiques suffisantes pour prévenir la contamination :
- les zones tampons doivent avoir au moins 8 m (26 pi 3 po) de largeur;
- une haie ou un brise-vent végétal permanent, un brise-vent artificiel, une route permanente ou une autre barrière peuvent être aménagés en lieu et place des zones tampons;
- les plantes cultivées dans les zones tampons ne doivent pas être considérées comme des produits biologiques, qu’elles soient utilisées à l’exploitation ou non;
- les cultures à risque de contamination par des cultures commerciales issues du génie génétique doivent être protégées de la contamination par pollinisation croisée. Des stratégies d’atténuation telles que, sans pour autant s’y limiter, des barrières physiques, des rangées périphériques, le recours à des tests stratégiques ou la pratique du semis différé doivent être mises en place, à moins que les distances d’isolement généralement acceptées pour ces types de cultures ne soient présentes (voir note ci-dessous).
Remarque
Les distances d’isolement généralement acceptées pour les cultures à risque de contamination par les cultures issues du génie génétique du même type sont les suivantes : pour le soja – 10 m (33 pi), le maïs – 300 m (984 pi), le canola, la luzerne (pour la production de semences) et les pommes – 3 km (1.8 mi).
5.2.3 Le bois non traité ou traité avec des substances qui figurent au tableau 4.2 (colonne 2) de la norme CAN/CGSB-32.311 est permis, par exemple pour les poteaux de clôture.
- Il est interdit d’utiliser des poteaux de clôture en bois traité avec des substances interdites pour de nouvelles installations ou à des fins de remplacement. Des matériaux de rechange tels que le métal, le plastique, le ciment et les enveloppes de protection peuvent être utilisés.
- Il est permis de recycler les poteaux existants dont le bois a été traité avec des substances interdites sur une même exploitation agricole.
5.2.4 Les pratiques de gestion doivent comprendre des mesures de protection et d’amélioration de la santé des écosystèmes de l’exploitation et intégrer l’un ou plusieurs des éléments suivants :
- habitat pour les pollinisateurs;
- bandes fleuries;
- habitat faunique;
- maintien ou restauration des rives ou des milieux humides; ou
- d’autres mesures pour promouvoir la biodiversité.
Remarque
Les habitats existants dans les prairies, terres humides ou forêts-parcs naturels devraient être préservés et améliorés chaque fois que cela est possible.
5.3 Semences et matériel de reproduction végétale
5.3.1 Il est exigé d’utiliser des semences, bulbes, tubercules, boutures, semis annuels, plants à repiquer, matériel de reproduction végétale et autres propagules biologiques. Les semences et le matériel de reproduction végétale biologiques peuvent être traités, trempés (activés) ou enrobés (pelliculés) avec des substances recensées aux tableaux 4.2 (colonnes 1 et 2) ou 7.3 de la norme CAN/CGSB-32.311.
5.3.2 Il est permis d’utiliser une variété de semences et de matériel de reproduction végétale non biologique à condition que :
- les semences ou le matériel de reproduction biologique ne puissent pas être produits ou obtenus sur l’exploitation; et
- les semences ou le matériel de reproduction biologique ne soient pas disponibles sur le marché après la recherche raisonnable effectuée auprès de fournisseurs potentiels reconnus de produits biologiques;
- les semences ou le matériel de reproduction ne soient traités, trempés (activés) ou enrobés (pelliculés) qu’avec des substances recensées aux tableaux 4.2 (colonnes 1 et 2) ou 7.3 de la norme CAN/CGSB-32.311, à l’exception des cas suivants :
- les semences activées avec des substances qui ne figurent pas aux tableaux 4.2 (colonnes 1 et 2) ou 7.3 de la norme CAN/CGSB-32.311 sont permises à condition que le processus de trempage n’inclue pas de pesticides non répertoriés dans les tableaux 4.2 (colonne 2) ou 7.3 de la norme CAN/CGSB-32.311;
- il est permis d’utiliser des semences et du matériel de reproduction végétale traités avec des substances nécessaires à la conformité aux règlements phytosanitaires ou de salubrité des aliments internationaux, fédéraux ou provinciaux et dont l’utilisation est approuvée par des agences de réglementation telles que l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA).
- Le matériel de reproduction végétale de plantes pérennes non biologique traité avec des substances interdites en 1.5 a, 1.5 b, 1.5 c ou 1.5 d doit être régi conformément à la présente norme pendant au moins 12 mois avant la première récolte de produits biologiques. La terre sur laquelle ce matériel est planté doit respecter les exigences énoncées en 5.1.1.
5.3.3 Les semis annuels d’hiver ou de printemps dont les plants seront transplantés dans l’exploitation peuvent être démarrés par l'exploitation sous des structures avec un éclairage artificiel à 100 % jusqu’à l’étape de la première transplantation, lorsque les plants issus du semis sont repiqués dans un autre milieu de culture (en cassette, en pot, en contenant ou en plein sol). Tous les paragraphes de 7.5, sauf 7.5.2.2, 7.5.2.3, 7.5.2.4 relatifs au volume de sol, s’appliquent aux semis annuels cultivés sous des structures.
5.4 Gestion de la fertilité du sol et des nutriments
5.4.1 Le programme de gestion de la fertilité du sol et des nutriments culturaux a pour objectif principal d’établir et de maintenir la fertilité du sol par des pratiques qui :
- préservent ou augmentent la teneur en matière organique du sol,
- favorisent un approvisionnement nutritionnel et un équilibre optimaux entre les nutriments, et
- stimulent l’activité biologique du sol.
5.4.2 La fertilité et l’activité biologique du sol doivent être maintenues ou accrues, selon le cas, par :
- la rotation des cultures, qui doit être aussi variée que possible et inclure notamment des engrais verts, des légumineuses, des cultures dérobées ou des plantes à enracinement profond
- l’incorporation de matières animales et végétales conformes à la présente norme et au tableau 4.2 (colonne 1) de la norme CAN/CGSB-32.311, y compris ce qui suit :
- les matières végétales et animales compostées
- les matières végétales non compostées, notamment les légumineuses, engrais verts ou plantes à enracinement profond dans le cadre d’un plan approprié de rotation pluriannuelle; et
- les déjections animales non traitées, y compris le purin et le lisier, qui respectent les exigences de 5.5.1
5.4.3 Le travail du sol et les pratiques culturales :
- doivent préserver ou améliorer l’état physique, chimique et biologique du sol,
- minimiser les dommages à la structure et à l’état d’ameublissement du sol, et
- minimiser l’érosion du sol.
5.4.4 La gestion des matières végétales et animales doit cibler la préservation ou l’amélioration de la fertilité du sol et de sa teneur en matière organique et en nutriments culturaux, de façon à ne pas favoriser la contamination des cultures, du sol ou de l’eau par des éléments fertilisants, des organismes pathogènes, des métaux lourds ou des résidus de substances interdites.
5.4.5 La matière organique produite dans l’exploitation doit être le fondement du programme de recyclage des éléments nutritifs avec, en complément, des sources d’éléments nutritifs décrites dans la présente norme ou répertoriées au tableau 4.2 (colonne 1) de la norme CAN/CGSB-32.311. Les déjections animales doivent aussi satisfaire aux exigences énoncées en 5.5.1.
5.4.6 L’élimination par brûlage des résidus de récolte produits sur l'exploitation est une pratique interdite. Cependant, le brûlage peut être utilisé pour contrer les problèmes documentés créés par les ravageurs, y compris les insectes, les maladies ou les mauvaises herbes (voir 5.6.1) ou pour stimuler la germination des semences.
5.5 Gestion des déjections animales
5.5.1 Sources des déjections animales
5.5.1.1 L’exploitant doit utiliser en premier les déjections animales produites dans sa propre exploitation biologique. Lorsque cette première source est épuisée, des déjections animales provenant d’autres exploitations biologiques peuvent être utilisées. Lorsque des déjections animales provenant d’exploitations biologiques ne sont pas disponibles sur le marché, des déjections animales provenant d’exploitations agricoles non biologiques peuvent être utilisées à condition que :
- l’opération non biologique ne fasse pas l’élevage d’animaux en cage où il leur est impossible de se mouvoir sur 360 degrés;
- les animaux d’élevage ne soient pas maintenus constamment dans l’obscurité; et
- l’origine et la quantité des déjections animales, le type d’animaux d’élevage ainsi que l’évaluation des critères mentionnés en 5.5.1.1 a et 5.5.1.1 b soient consignés.
Remarque
Les exploitations biologiques devraient utiliser, en priorité, des déjections animales qui proviennent d’exploitations en conversion ou pratiquant l’élevage extensif et éviter, comme sources de déjections animales, les élevages hors-sol ou les exploitations qui utilisent des ingrédients issus du génie génétique ou leurs dérivés en alimentation animale.
5.5.2 Épandage au sol des déjections animales
5.5.2.1 Le plan d’épandage des déjections animales doit tenir compte de la superficie du terrain, des doses, de l’époque de l’année, ainsi que de l’incorporation au sol et de la rétention des nutriments.
5.5.2.2 Tout amendement du sol, que ce soit le purin, le lisier, le thé de compost, le fumier solide, le fumier brut, le compost et les autres substances énumérées au tableau 4.2 (colonne 1) de la norme CAN/CGSB-32.311, doit être appliqué sur le sol conformément aux bonnes pratiques de gestion des nutriments.
Remarque
Au Canada, des exigences provinciales additionnelles peuvent également s’appliquer.
5.5.2.3 L Lors de l’épandage des déjections animales, le sol doit être suffisamment chaud et humide pour assurer une oxydation biologique active.
5.5.2.4 Le moment de la saison, le taux et la méthode d’application établis doivent assurer que les déjections animales :
- ne contribuent pas à la contamination des cultures par des bactéries pathogènes;
- ne s’écoulent pas de manière significative dans les étangs, les rivières et les ruisseaux;
- ne contribuent pas notablement à la contamination de la nappe phréatique ou des eaux de surface.
5.5.2.5 Les déjections animales non compostées solides ou liquides doivent :
- être incorporées au sol au moins 90 jours avant la récolte de cultures destinées à la consommation humaine qui n’entrent pas en contact avec le sol; ou
- être incorporées au sol au moins 120 jours avant la récolte de cultures dont la partie comestible est directement en contact avec la surface ou des particules de sol.
5.5.2.6 Lorsque des animaux d’élevage font partie du programme de culture ou de contrôle des organismes nuisibles, un plan de gestion doit être mis en place pour assurer que les animaux d’élevage sont maîtrisés et que leurs déjections ou une contamination liée à leurs déjections n’affectent pas la partie des cultures qui sera récoltée.
5.5.3 Traitement des déjections animales
Les déjections animales qui ont subi un traitement physique (par exemple, la déshydratation), biologique ou chimique à l’aide de substances énumérées au tableau 4.2 (colonnes 1 et 2) de la norme CAN/CGSB‑32.311 sont permises. Les techniques de traitement des déjections animales doivent minimiser les pertes d’éléments nutritifs.
5.6 Gestion des ravageurs, incluant les insectes, les maladies et les mauvaises herbes
5.6.1 La lutte contre les ravageurs, incluant les insectes, les maladies et les mauvaises herbes, doit être axée sur des pratiques de gestion biologique qui améliorent la santé des plantes et réduisent les pertes attribuables à ces ravageurs. Ces pratiques comprennent les pratiques culturales (les rotations, l’établissement d’un écosystème équilibré et l’utilisation de variétés résistantes), les méthodes mécaniques (les mesures sanitaires, le travail du sol, les pièges, les paillis et le pâturage) et les méthodes physiques (le brûlage des mauvaises herbes, la chaleur contre les maladies).
5.6.2 Si les pratiques de gestion biologique ne suffisent pas à prévenir la présence ou combattre les ravageurs, incluant les insectes, les maladies et les mauvaises herbes, il est possible d’appliquer des substances biologiques ou botaniques ou d’autres substances répertoriées au tableau 4.2 (colonnes 1 et 2) de la norme CAN/CGSB-32.311. Les conditions d’utilisation de ces substances doivent être décrites dans le plan de production biologique (voir la section 4).
5.6.3 Le matériel d’application, tels les pulvérisateurs, utilisé pour l’application de substances interdites doit être nettoyé à fond avant d’être utilisé en production biologique.
5.7 Irrigation
L’irrigation de cultures biologiques est permise si l’exploitant documente les précautions prises pour prévenir la contamination de la terre et des produits par des substances qui ne sont pas répertoriées dans la norme CAN/CGSB-32.311.
5.8 Préparation des produits végétaux
Les articles 8.1 et 8.2 s’appliquent lors de la préparation des produits biologiques.
5.9 Gestion des organismes nuisibles en installations
L'article 8.3 s’applique à la gestion de la lutte contre les organismes nuisibles à l’intérieur et autour des installations.
6 Production d’animaux d’élevage
Les animaux d’élevage excluent l’apiculture qui est traitée à l'article 7.1.
L’article 8.4 relatif au transport s’applique lorsque les animaux d’élevage biologique sont transportés.
6.1 Généralités
6.1.1 Les animaux d’élevage peuvent contribuer de manière importante à un système agricole biologique :
- en améliorant et en maintenant la fertilité du sol;
- en soutenant la régie de la flore par le pâturage;
- en améliorant la biodiversité; et
- en facilitant les interactions complémentaires au sein de l’exploitation agricole.
6.1.2 Dans une production biologique, les animaux doivent être élevés conformément à la présente norme.
6.1.3 La production d’animaux d’élevage est une activité intimement liée au sol :
- Les herbivores doivent avoir accès aux pâturages durant la saison de pâturage, ainsi qu'un accès à l’extérieur à d’autres moments, lorsque les conditions climatiques le permettent :
- sur une base de matière sèche, la consommation de fourrage pâturé doit représenter au minimum 30 % de l’ingestion totale de fourrage pour les ruminants qui ont atteint l’âge de maturité sexuelle;
- la consommation de fourrage pâturé doit augmenter à plus de 30 % pendant les périodes de forte croissance du fourrage;
- un minimum de 0,13 ha (0.33 acre) par unité animale doit être consacré au pâturage. (1 unité animale = 1 vache ou 1 taureau, ou 2 veaux pesant chacun entre 102 et 227 kg (225 à 500 lb), ou 5 veaux pesant chacun moins de 102 kg (225 lb) ou 4 brebis et leurs agneaux, ou 6 chèvres et leurs petits).
- Les autres animaux d’élevage, y compris la volaille, doivent avoir accès à l’extérieur lorsque les conditions climatiques le permettent;
- L’élevage exclusivement hivernal de la volaille est réservé aux exploitations qui sont en mesure de respecter pleinement les exigences relatives aux aires extérieures pour les animaux d’élevage en cause, quelle que soit l’époque de l’année (voir 6.13.13);
- Des exceptions en 6.7.2 et 6.11 peuvent s’appliquer.
6.1.4 La capacité de charge doit tenir compte de la différence entre les régions agroclimatiques du Canada et de la capacité de production fourragère, de la santé des animaux d’élevage, de l’équilibre nutritif et des incidences sur l’environnement.
6.1.5 La gestion des animaux d’élevage doit faire appel à des méthodes de reproduction naturelles, minimiser le stress, prévenir les maladies, viser l’élimination progressive du recours aux médicaments allopathiques chimiques d’usage vétérinaire (y compris les antibiotiques) et préserver la santé et le bien-être des animaux.
6.1.6 Comme principe général, l’exploitant doit démontrer qu’il s’engage à promouvoir le bien-être animal. Quand un enjeu lié au bien-être des animaux est identifié, l’exploitant doit élaborer un plan de mesures correctives. L’exploitant devra fournir au besoin des documents qui démontrent des améliorations dans les pratiques relatives au bien-être des animaux, y compris tous les documents ou toutes les évaluations qui sont exigées par des associations de l’industrie.
6.2 Origine des animaux d’élevage
6.2.1 Les races, souches et types d’animaux d’élevage doivent :
- pouvoir s’adapter aux conditions propres à l’environnement local et au système de production;
- être reconnus pour l’absence de maladies et de problèmes de santé, propres à certaines races ou souches;
- être reconnus pour leur vitalité et leur résistance aux maladies et aux parasites les plus répandus.
6.2.2 L’exploitant qui élève les animaux :
- doit utiliser des méthodes de reproduction naturelles. L’insémination artificielle est permise, incluant l’utilisation de semences sexées si les semences sont séparées mécaniquement;
- ne doit pas utiliser des techniques de transplantation d’embryons, ou des techniques de reproduction ayant recours au génie génétique ou à des technologies connexes;
- ne doit pas utiliser d’hormones de reproduction pour déclencher et synchroniser les chaleurs.
6.2.3 Animaux d’élevage utilisés pour la production des produits d’élevage biologiques
6.2.3.1 Les animaux d’élevage utilisés en production de produits d’élevage biologiques doivent :
- être nés ou avoir éclos dans des unités de production biologique;
- être la progéniture de parents élevés en production biologique;
- avoir passé leur vie entière dans un système de production biologique.
6.2.3.2 Des exceptions à 6.2.3.1 a, 6.2.3.1b et c s’appliquent à la volaille :
- la volaille doit avoir fait l’objet d’une gestion biologique continue, commençant au plus tard le deuxième jour suivant la naissance; et
- les œufs fécondés et les volailles d’un jour ne doivent pas recevoir de médicaments autres que des vaccins.
6.2.3.3 Une exception en 6.2.3.1 a, 6.2.3.1b et c est possible lorsqu’un troupeau ou des animaux individuels (utilisés comme nouveaux reproducteurs) provenant de l’exploitation ou de l’extérieur (conformément à 6.2.4) sont convertis à la production biologique :
- les animaux utilisés pour la production laitière doivent avoir fait l’objet d’une gestion biologique continue pendant au moins 12 mois;
- les animaux utilisés pour la viande doivent avoir fait l’objet d’une gestion biologique continue, et ce, à compter du début du dernier tiers de la période de gestation de la mère.
6.2.4 Les animaux achetés pour la reproduction doivent être biologiques. Cependant :
- si aucun animal d’élevage biologique n’est disponible dans le commerce, les sujets de reproduction non gestants et les mâles reproducteurs non biologiques peuvent être transférés à une exploitation biologique et être intégrés au système biologique. Toutefois, la viande de ces animaux ne sera pas biologique;
- s’ils sont transférés vers une autre exploitation biologique, les animaux d’élevage provenant de sources non biologiques conformes à 6.2.4 a, ne doivent pas être considérés comme animaux reproducteurs biologiques, ou comme animaux de boucherie biologiques;
- lors de l’élargissement d’un troupeau et de l’ajout de terres, les nouveaux animaux reproducteurs introduits à l'exploitation peuvent consommer du fourrage des terres en troisième année de conversion jusqu’à la fin du second trimestre;
- l’intégration d’animaux en lactation non biologiques dans une unité d’exploitation laitière biologique est interdite;
- en cas d’événements catastrophiques, tels l’incendie d’un bâtiment ou une maladie nécessitant le repeuplement du troupeau, des animaux reproducteurs non biologiques (à l’exclusion des volailles) peuvent être intégrés dans une exploitation biologique avant le dernier tiers de la gestation, si des animaux biologiques appropriés ne sont pas disponibles sur le marché.
6.2.5 Les animaux d’élevage ou les produits d’animaux d’élevage qui ont été retirés d’une exploitation biologique et introduits ultérieurement dans une exploitation non biologique ne doivent pas être considérés comme étant biologiques.
6.3 Conversion des unités de production d'animaux d'élevage à la production biologique
(à l’exception des volailles couvertes en 6.13.1)
6.3.1 Lorsqu’un troupeau laitier complet est converti à la production biologique, l’exploitant doit :
- durant les neuf premiers mois de la période de conversion de 12 mois, nourrir les animaux avec des aliments provenant à au moins 80 %, calculés à l’état sec, de sources biologiques ou cultivés sur des terres incluses dans le plan de production biologique et gérées conformément aux exigences décrites à la section 5, Productions végétales, de la présente norme;
- à compter des trois derniers mois de la période de conversion de 12 mois, nourrir les animaux avec seulement des aliments biologiques.
6.3.2 La conversion des terres destinées à la production d’aliments pour animaux ou au pâturage doit être conforme à 5.1.
6.3.3 Lorsqu’une unité de production comprenant un troupeau d’animaux d’élevage ou de moutons est en cours de conversion vers le mode de production biologique, les pâturages et aliments pour animaux produits durant les 12 derniers mois de la période de conversion des terres peuvent être considérés comme biologiques et consommés par les animaux d’élevage de cette même unité de production. Ces mêmes aliments pour animaux ne doivent pas être considérés comme biologiques à l’extérieur de l’unité de production.
6.4 Aliments des animaux d’élevage
6.4.1 L’exploitant doit nourrir les animaux de son élevage avec des rations équilibrées d’aliments biologiques répondant à leurs besoins nutritionnels.
6.4.2 Les aliments des animaux d’élevage doivent être composés de substances qui sont nécessaires et essentielles au maintien de la santé, au bien-être et à la vitalité des animaux, et qui répondent aux besoins physiologiques et comportementaux des espèces en question.
6.4.3 Les rations propres à chaque espèce animale doivent tenir compte des points suivants :
- pour les jeunes mammifères, le besoin de lait naturel, y compris le colostrum, au premier jour de vie;
- dans les exploitations laitières, les veaux, les agneaux et les chevreaux peuvent être séparés de leurs mères à l’âge de 24 h à condition qu’ils aient reçu du colostrum. Si des maladies contagieuses affectent le troupeau, les animaux peuvent être retirés plus tôt à condition qu’ils reçoivent du colostrum;
- lorsqu’il est nécessaire de séparer les veaux de boucherie, les agneaux et autres jeunes de leur mère afin de prévenir la propagation de maladies contagieuses, l’utilisation de lait non biologique ou de lait de remplacement non biologique est permise par exception dans le cadre d’un plan d’éradication de la maladie approuvé par un vétérinaire, si les alternatives biologiques ne sont pas disponibles sur le marché. Le plan d’éradication approuvé par un vétérinaire doit comprendre un calendrier ainsi que des mesures préventives, telles que des analyses de lait, de sang ou de fumier ou la pasteurisation du lait. Par ordre de préférence, les produits suivants peuvent être utilisés : le lait biologique (y compris le lait pasteurisé), le lait de remplacement biologique, le lait non biologique et le lait de remplacement non biologique à la condition qu’ils soient exempts de médicaments;
- jusqu’à l’âge de trois mois, les veaux doivent recevoir du lait biologique entier et frais ou du lait biologique reconstitué, à condition qu’il ne contienne pas de médicaments;
- les veaux peuvent être nourris avec le lait d’une vache biologique qui a reçu un traitement antibiotique si une période de retrait égale à deux fois la période de retrait indiquée sur l’étiquette du médicament administré, ou 14 jours, selon la plus longue éventualité, est appliquée;
- les agneaux et chevreaux doivent être nourris de lait biologique entier et frais ou reconstitué jusqu’à l’âge de deux mois ou après avoir atteint un poids de 18 kg (39.7 lb);
- lorsqu’ils ne sont pas allaités par la mère, les besoins nutritionnels des jeunes animaux doivent être comblés en recourant aux tétines artificielles afin de satisfaire leur besoin de téter et assurer une croissance et une santé optimales;
- les veaux de race laitière doivent avoir accès à des aliments solides en tout temps;
Remarque
Consulter le Code de pratiques pour le soin et la manipulation des bovins laitiers pour connaître les recommandations relatives à l’alimentation par le colostrum et la quantité de lait à fournir aux veaux de race laitièreNote de bas de page 4.
- dans le cas des ruminants, au moins 60 % de la matière sèche des rations quotidiennes doit être composée de foin, de fourrage frais ou séché ou de fourrage conservé sous forme ensilée (graminées, légumineuses, ensilage de maïs). Une augmentation de la ration de grains est autorisée afin de satisfaire les besoins nutritionnels des animaux lorsqu’un froid extraordinaire survient ou lorsque la qualité du fourrage est compromise en raison de phénomènes météorologiques extraordinaires;
- lorsque les ruminants sont nourris de fourrage conservé sous forme ensilée, au moins 15 % de la matière sèche totale de la ration quotidienne doit être composée de fourrage à longues fibres (la longueur de la tige doit être supérieure à 10 cm [4 po]). Le maïs conservé sous forme ensilée utilisé comme aliment doit être considéré comme contenant 40 % de grains et 60 % de fourrage, à moins qu’une analyse indique le contraire. La proportion de grains dans le maïs conservé sous forme ensilée doit être incluse dans le pourcentage de grains de la ration (voir 6.4.3 i);
- durant la phase de finition, la volaille doit recevoir du grain;
- la volaille et les porcs doivent recevoir des matières végétales autres que le grain;
- la volaille doit être nourrie tous les jours. Les oiseaux reproducteurs ne doivent pas être soumis à un régime d’alimentation périodique (un jour sur deux);
- les lapins ont besoin de fourrage (herbe, foin) et doivent avoir accès à certains matériaux pour conserver une saine dentition (par exemple, des blocs à ronger, plantes-racines potagères ou branches d’arbre). Les matériaux constituants des blocs à ronger doivent être répertoriés au tableau 5.2 de la norme CAN/CGSB-32.311.
6.4.4 Les aliments, additifs et suppléments suivants sont interdits :
- des aliments et des additifs pour alimentation animale, y compris des acides aminés et des suppléments alimentaires, contenant des substances non répertoriées au tableau 5.2 de la norme CAN/CGSB-32.311;
- des médicaments incorporés aux aliments ou des médicaments d’usage vétérinaire, y compris les hormones et les antibiotiques prophylactiques, afin d’accélérer la croissance;
- des suppléments ou des additifs alimentaires approuvés, mais utilisés en quantités supérieures à celles requises pour une nutrition adéquate et le maintien d’un bon état de santé, pour une espèce donnée à une étape précise de sa vie;
- des aliments extraits chimiquement ou dégraissés avec des substances interdites;
- des aliments contenant des sous-produits d’abattage de mammifères ou de volaille;
- des aliments contenant des agents de conservation, à moins qu’ils ne soient énumérés au tableau 5.2 de la norme CAN/CGSB-32.311;
- des produits de conservation d’ensilage, sauf les produits énumérés au tableau 5.2 de la norme CAN/CGSB-32.311;
- des stimulateurs d’appétit ou des exhausteurs de goût, à moins qu’ils ne soient énumérés au tableau 5.2 de la norme CAN/CGSB-32.311;
- des formules d’aliments pour animaux contenant des déjections animales ou d’autres déchets animaux;
- des aliments contenant des colorants, à moins qu’ils ne soient énumérés au tableau 5.2 de la norme CAN/CGSB-32.311.
6.4.5 Les animaux d’élevage de tout âge doivent avoir accès à de l’eau fraîche et propre à volonté. Les sources d’eau doivent être testées conformément aux lignes directrices de qualité de l’eau potable des animaux d’élevage et conformément aux procédures établies dans les codes de pratique (voir 2.4) et programmes d’assurance de la qualité des associations de producteurs concernés.
6.4.6 Le gavage des canards et des oies est interdit.
6.4.7 Par exception, il est permis de donner des aliments non biologiques dans les circonstances suivantes :
- advenant un événement catastrophique ayant un impact direct sur l’unité de production (comme un incendie, une inondation ou des conditions climatiques extraordinaires) où il est impossible d’obtenir des aliments biologiques, des aliments non biologiques peuvent être consommés pour une période maximale de dix jours consécutifs (ou jusqu’à 30 % d’aliments non biologiques pendant une durée maximale de 30 jours consécutifs) afin que les animaux d’élevage reçoivent une alimentation équilibrée. Les aliments provenant de terres en conversion vers la production biologique et réputés exempts de substances interdites doivent être utilisés de préférence aux aliments non biologiques;
- les animaux reproducteurs peuvent être nourris avec des fourrages non biologiques en cas de pénuries régionales de fourrage, documentées par l’exploitant et confirmées, si possible, par une autorité régionale, à condition que ces animaux soient séparés, visuellement distinguables (à l’aide d’étiquettes d’oreille, ou par les registres de vérification de l’âge) et que la tenue des registres soit assurée. Les fourrages provenant de terres en conversion vers la production biologique ou réputés exempts de substances interdites doivent être utilisés de préférence aux fourrages non biologiques. Les fourrages provenant de cultures génétiquement modifiées sont interdits. Sinon, à tous les autres égards, la régie des animaux reproducteurs dont la descendance sera biologique doit être conforme à la présente norme en tout temps. Les animaux reproducteurs doivent être resoumis à la conversion lorsque des fourrages biologiques sont de nouveau accessibles. Le paragraphe 6.2.3 s’applique à la descendance. Le statut biologique des autres animaux d’élevage de l’exploitation n’est pas touché;
- en cas de pénurie de fourrage documentée et, si possible, confirmée par une autorité régionale, si les quantités d’aliments autorisées en 6.4.7 b s’avèrent insuffisantes, les fourrages non biologiques peuvent constituer jusqu’à 25 % de la ration fourragère du troupeau entier de ruminants, en respectant cet ordre de priorité :
- fourrage non biologique provenant de terres en conversion;
- fourrage non biologique cultivé sans substances interdites;
- fourrage non biologique cultivé sans substances interdites pendant au moins 60 jours avant la récolte;
- fourrage non biologique provenant d’une culture non génétiquement modifiée;
- L’exploitant doit élaborer un plan de contingence pour parer aux prochaines pénuries de fourrages. Ce plan doit comprendre des stratégies telles que la culture de variétés mieux adaptées au climat, l’amélioration des pratiques de pâturage, la constitution de stocks de fourrages, le recensement d’autres chaînes d’approvisionnement, la variation de la taille du troupeau et une production fourragère plus résiliente à la ferme.
Remarque
Pour l'exception prévue à 6.4.7 a, l'organisme de certification devrait être informé dès que possible de l'utilisation d'aliments pour animaux ou de fourrages non biologiques. Pour l'exception prévue à 6.4.7 b et 6.4.7 c, l'organisme de certification devrait être informé avant l'utilisation d'aliments pour animaux ou de fourrages non biologiques.
6.5 Transport et manutention
6.5.1 Les animaux d’élevage doivent être régis de façon responsable, avec soin et respect. Le stress, les blessures et la souffrance physique doivent être minimisés lors de l’exécution des diverses manutentions, tels le transport et l’abattage.
6.5.2 La densité de chargement des véhicules de transport doit être conforme aux pratiques recommandées dans le Code de pratiques pour les soins et la manipulation des animaux d’élevage – Transport. (voir 2.4). L’utilisation de stimulation électrique ou de tranquillisants allopathiques est interdite.
6.5.3 Pendant le transport et avant l’abattage, les animaux doivent disposer d’un abri adéquat contre les conditions climatiques défavorables comme le vent, la pluie, la chaleur ou le froid excessifs.
6.5.4 Si possible, il faut transporter les animaux directement de l’exploitation à leur destination finale.
6.5.5 La durée du transport doit être la plus courte possible. Si le voyage est d’une durée de plus de 5 h, l’exploitant doit respecter les recommandations concernant les durées maximales de transport et les exigences minimales relatives à l’alimentation, à l’abreuvement et au repos, conformément au Code de pratiques pour les soins et la manipulation des animaux d’élevage – Transport.
6.5.6 L’aptitude au transport doit être évaluée avant le chargement. Les animaux d’élevage inaptes ou malades ne doivent pas être transportés, tels ceux qui sont blessés, qui boitent, les animaux émaciés, les animaux en fin de période de gestation ou présentant une lactation abondante.
6.5.7 Si des animaux inaptes au transport doivent être euthanasiés, l’euthanasie doit être effectuée par du personnel compétent au moyen d’un équipement approprié. La méthode employée doit être rapide et causer le moins de douleur et de détresse possible.
Remarque
Au Canada, se reporter également au Règlement sur la santé des animaux de la Loi sur la santé des animaux (Agence canadienne d’inspection des aliments). Pour obtenir des directives à cet égard, consulter le Code de pratiques pour chaque type d’animal (voir 2.4).
6.6 Soins de santé des animaux d’élevage
6.6.1 L’exploitant doit mettre en place et utiliser des pratiques préventives en soins de santé des animaux d’élevage, y compris :
- la sélection de races ou de souches d’animaux d’élevage appropriées conformément à 6.2.1;
- la distribution d’une ration alimentaire suffisante pour répondre aux besoins nutritifs des animaux, notamment en vitamines, minéraux, protéines, acides gras, sources d’énergie et fibres;
- un logement, des conditions de pâturage, l’attribution d’espace et des pratiques sanitaires qui minimisent le surpeuplement ainsi que l’apparition et la propagation de maladies et de parasites;
- des conditions appropriées pour chaque espèce afin de permettre l’exercice, la liberté de mouvement et diminuer le stress;
- le traitement rapide des animaux atteints de maladies, de lésions, de claudication, de blessures et d’autres malaises physiques;
- la vaccination effectuée conformément à la présente norme et au tableau 5.3 de la norme CAN/CGSB-32.311, lorsqu’il est établi que les maladies visées sont contagieuses pour les animaux d’élevage de l’unité de production ou de l’exploitation et qu’elles ne peuvent être combattues par d’autres moyens.
6.6.2 L’exploitant ne doit pas administrer :
- des médicaments vétérinaires, autres que les vaccins, s’il n’y a aucune maladie. Des agents anesthésiques et analgésiques sont permis, mais assujettis aux exigences relatives aux modifications physiques énoncées en 6.6.4;
- des substances synthétiques qui stimulent ou ralentissent la croissance ou la production, dont les hormones qui stimulent la croissance;
- des parasiticides synthétiques, sauf dans les cas d’exception décrits en 6.6.11;
- des antibiotiques aux animaux d’élevage ou oiseaux abattus pour la viande ou destinés à la production d’œufs;
- des médicaments vétérinaires allopathiques chimiques en traitement préventif, comme des produits pharmaceutiques, des antibiotiques, des hormones et des stéroïdes.
6.6.3 Tout traitement hormonal ne peut être administré que pour des raisons thérapeutiques et sous la supervision d’un vétérinaire. La viande provenant d’animaux traités ne doit pas être considérée comme biologique, à moins que le traitement soit énuméré au tableau 5.3 de la norme CAN/CGSB-32.311.
6.6.4 Les modifications physiques sont interdites, sauf quand elles sont absolument nécessaires à la santé, au bien-être ou à l’hygiène des animaux, pour les identifier ou pour des raisons de sécurité.
- Les modifications physiques suivantes sont permises; les restrictions mentionnées en 6.6.4 c s’appliquent :
- la castration de porcelets, d’agneaux, de chevreaux et de veaux;
- la caudectomie des agneaux;
- le marquage et l’étiquetage des oreilles;
- l’ébourgeonnage ou la taille des bourgeons des cornes.
- Les modifications physiques suivantes ne sont permises que si elles constituent la seule option restante; les restrictions mentionnées en 6.6.4 c s’appliquent :
- l’épointage du bec pour retirer le bout pointu;
- la taille des canines des porcelets;
- la caudectomie des porcs et des bovins;
- l’écornage.
- Ces restrictions s’appliquent aux modifications physiques :
- les modifications physiques doivent être faites en minimisant la douleur, le stress et la souffrance;
- quel que soit l’âge de la bête et quelle que soit la méthode choisie pour exécuter la procédure, il faut considérer la possibilité de recourir aux anesthésiques, aux sédatifs et aux analgésiques anti-inflammatoires qui ne contiennent pas de stéroïdes, comme la lidocaïne, la xylazine et le kétoprofène;
- pour les modifications physiques telles que la castration, la caudectomie, l’écornage, la taille des bourgeons et le marquage, les exploitants doivent consulter les Codes de pratiques spécifiques (voir 2.4) qui décrivent les restrictions liées à l’âge, à la méthode utilisée et à l’utilisation de médicaments contre la douleur;
- l’épointage du bec des oiseaux, la caudectomie des porcs et la taille des canines des porcelets ne sont permis que lorsqu’ils sont nécessaires au contrôle des problèmes de comportement qui nuisent au bien-être des autres animaux d’élevage. Les exploitants doivent documenter les autres mesures prises pour limiter ou éliminer les comportements nuisibles;
- la caudectomie des bovins est permise seulement lorsqu’il faut administrer un traitement vétérinaire à des animaux blessés;
- les porcelets doivent être castrés dans les deux premières semaines de vie de l’animal. La castration des verrats de réforme est interdite; et
- la stérilisation des bovins de boucherie de sexe femelle est interdite.
6.6.5 Les traitements ou pratiques biologiques, culturales et physiques décrits au tableau 5.3 de la norme CAN/CGSB-32.311 sont permis lorsque les pratiques préventives et les vaccins ne permettent pas de prévenir les maladies ou les blessures et qu’un traitement est requis.
6.6.6 Il est interdit de priver d’un traitement médical un animal d’élevage malade ou blessé afin de maintenir son statut biologique. Tous les médicaments appropriés doivent être utilisés pour que l’animal d’élevage recouvre la santé quand les méthodes autorisées en production biologique échouent.
6.6.7 Les animaux d’élevage blessés ou malades dont la présence comporte un risque pour la santé d’autres animaux ou oiseaux doivent être séparés du troupeau, ou euthanasiés, au besoin (voir 6.6.13).
6.6.8 Il est interdit d’envoyer à l’abattoir un animal d’élevage malade à des fins de consommation humaine.
6.6.9 Les produits provenant d’animaux malades ou soumis à un traitement à base de substances d’usage restreint ne doivent être ni biologiques, ni donnés comme nourriture aux animaux d’élevage biologiques.
6.6.10 L’utilisation de substances médicales d’usage vétérinaire doit être conforme à ce qui suit :
- s’il n’existe aucun autre traitement ni pratique de gestion, les produits biologiques vétérinaires, notamment les vaccins, les parasiticides ou les médicaments, peuvent être administrés à condition qu’ils soient conformes aux exigences de la présente norme et au tableau 5.3 de la norme CAN/CGSB-32.311 ou qu’ils soient exigés en vertu d’une loi;
- les produits phytothérapeutiques, c’est-à-dire les composés botaniques comme l’atropine, le butorphanol et les autres médicaments provenant de plantes herbacées, à l’exclusion des antibiotiques, et les produits homéopathiques ou autres produits similaires doivent être préférés aux médicaments allopathiques chimiques d’usage vétérinaire ou aux antibiotiques, à condition que leur effet thérapeutique soit efficace pour l’espèce concernée et qu’ils conviennent à l’affection traitée;
- si les produits permis en 6.6.10 a et 6.6.10b sont inefficaces pour combattre la maladie ou traiter la blessure, des médicaments vétérinaires non répertoriés dans la présente norme ou au tableau 5.3 de la norme CAN/CGSB-32.311 peuvent être administrés aux animaux de reproduction, aux pondeuses ou aux animaux laitiers avec l’autorisation écrite d’un vétérinaire. Certaines restrictions s’appliquent (voir 6.6.2, 6.6.11 d et 6.6.12). À l’exception des parasiticides administrés en vertu du paragraphy 6.6.11, la viande provenant d’animaux traités avec des médicaments vétérinaires non répertoriés au tableau 5.3 de la norme CAN/CGSB-32.311 n’est pas biologique;
- lorsque des médicaments vétérinaires sans exigences de retrait spécifiques sont administrés, une période de retrait égale au double de l’exigence mentionnée sur l’étiquette ou 14 jours, selon la plus longue des deux, doit être observée avant que les produits des animaux d’élevage traités puissent être considérés comme biologiques;
- les animaux auxquels il faut administrer des antibiotiques ou d’autres substances interdites en vertu de l'alinéa 1.5 e pendant trois années consécutives pour la même maladie doivent être retirés du troupeau dans un délai de neuf mois débutant à la suite du dernier traitement;
- il est permis d’administrer un traitement antibiotique aux animaux laitiers en cas d’urgence, aux conditions suivantes :
- l’exploitant doit avoir reçu d’un vétérinaire des instructions écrites décrivant le produit utilisé et la méthode de traitement;
- la période de retrait du lait doit être d’au moins 30 jours, débutant après le dernier jour du traitement, ou correspondre au double de la période de retrait mentionnée sur l’étiquette, selon la plus longue des deux périodes;
- l’utilisation d’antibiotiques doit être consignée dans les registres de santé du troupeau;
- les animaux laitiers qui reçoivent par année plus de deux traitements par des médicaments vétérinaires, qu’il s’agisse d’antibiotiques ou de parasiticides, ou d’un de chacun, perdent leur statut biologique et doivent être soumis à une période de conversion de 12 mois.
6.6.11 Les entreprises d’élevage biologique doivent adopter un plan complet visant à minimiser les problèmes parasitaires. Le plan doit comprendre des mesures préventives telles que la sélection génétique, la gestion du pâturage, l’analyse des matières fécales, l’évaluation des tissus lors de l’abattage, ainsi que des mesures d’urgence en cas d’épidémie de parasites. Le plan doit aussi inclure des méthodes de nettoyage et de désinfection des bâtiments d’élevage, telles que le lavage à pression, le lavage à la vapeur, le brûlage de plancher et le nettoyage au lait de chaux, ainsi que le vide sanitaire. Par exception, lorsque les mesures préventives échouent en raison, par exemple, de conditions climatiques ou d’autres facteurs incontrôlables, l’exploitant peut utiliser des parasiticides ne figurant pas au tableau 5.3 de la norme CAN/CGSB-32.311, à condition que :
- l’observation de l’animal, les échantillons des matières fécales ou l’évaluation des tissus, selon l’espèce, révèlent que les animaux sont infestés de parasites;
- l’exploitant ait un plan d’action écrit, avec calendrier, expliquant comment il modifiera son plan de contrôle des parasites afin d’éviter d’autres situations d’urgence similaires;
- l’exploitant ait reçu d’un vétérinaire une prescription écrite décrivant le produit et la méthode de contrôle qui doit être utilisée, y compris des dispositions visant à éviter le développement de la résistance des parasites, telle que la rotation des parasiticides;
- les périodes de retrait égalent le double des exigences prévues sur l’étiquette, ou 14 jours, selon la plus longue des deux périodes.
Une fois ces conditions satisfaites, les restrictions suivantes s’appliquent :
- une exception pour un groupe d’animaux ou pour une unité de production complète ne peut être accordée plus de deux années consécutives pour un même problème;
- une mère ne peut recevoir qu’un seul traitement antiparasitaire pendant sa période de gestation;
- les animaux de boucherie de moins de 12 mois, quelle que soit l’espèce, ne peuvent recevoir qu’un seul traitement antiparasitaire. Les animaux de boucherie âgés de 12 mois ou plus qui reçoivent plus de deux traitements antiparasitaires au cours de leur vie perdent leur statut biologique;
- les animaux laitiers qui ont besoin de plus de deux traitements par période de 12 mois, qu’il s’agisse d’antibiotiques ou de parasiticides, ou d’un de chacun, perdent leur statut biologique et doivent être soumis à une période de conversion de 12 mois;
- la viande des animaux laitiers de réforme qui reçoivent plus de deux traitements de parasiticides au cours de leur vie ne doit jamais être considérée comme biologique;
- la viande des animaux laitiers de réforme qui reçoivent des antibiotiques au cours de leur vie ne doit jamais être considérée comme biologique;
- les animaux reproducteurs porcins qui présentent une charge parasitaire élevée peuvent recevoir jusqu'à trois traitements antiparasitaires par an dans le cadre d'un plan de réduction des parasites. Cette exception ne peut pas être systématiquement appliquée (conformément aux points 6.6.11 b et 6.6.11e);
- les poules pondeuses qui requièrent plus de deux traitements antiparasitaires par période de 12 mois perdent le statut biologique. Le traitement d’une bande de volailles, plutôt que de poules individuelles, est permis.
6.6.12 Les animaux reproducteurs ou la volaille traités au moyen d’un parasiticide ou d’un médicament d’usage vétérinaire ne figurant pas au tableau 5.3 de la norme CAN/CGSB-32.311 ne doivent pas être considérés comme animaux de boucherie biologiques. Des exceptions concernant les traitements antiparasitaires peuvent s’appliquer (voir 6.6.11).
6.6.13 Les animaux blessés ou malades doivent recevoir un traitement individuel conçu pour atténuer leurs douleurs et leur souffrance, y compris l’euthanasie.
6.6.14 La mue forcée des volailles est interdite.
6.7 Conditions d’élevage
6.7.1 L’exploitant doit mettre en place et maintenir des conditions d’élevage adaptées à la santé et au comportement naturel de tous les animaux, notamment :
- l’accès aux aires extérieures, à un lieu ombragé, à un abri, à des pâturages en rotation, à des aires d’exercice, à de l’air frais et à la lumière du jour en fonction des espèces, du stade de production, du climat et de l’environnement;
- l’accès à l’eau potable (voir 6.4.5) et à des aliments de haute qualité selon les besoins de l’animal;
- un espace suffisant et une liberté de mouvement pour s’allonger en position couchée, se tenir debout, s’étirer les pattes, se retourner librement et adopter des comportements normaux;
- l’allocation de superficies en fonction des conditions locales, de la capacité de production d’aliments pour animaux de l’exploitation, de l’état de santé des animaux d’élevage, de l’équilibre nutritif des animaux d’élevage et du sol, et des impacts sur l’environnement;
- des techniques de production qui favorisent la santé à long terme des animaux d’élevage, quand l’exploitation vise l’atteinte d’un niveau de production ou un taux de croissance élevé;
- une bonne qualité de l’air; le taux d’humidité, les particules de poussière et les niveaux d’ammoniac ne doivent pas nuire au bien-être des animaux. Les niveaux d’ammoniac ne doivent pas dépasser 25 ppm. Une mesure corrective doit être mise en place quand les niveaux dépassent 25 ppm;
- des espaces appropriés recouverts de litière et des aires de repos qui répondent aux besoins de l’animal. Les espaces intérieurs doivent être suffisamment grands, bâtis solidement, confortables, propres et secs. Les aires de repos doivent être recouvertes d’une épaisse litière sèche qui absorbe les excréments. Si la litière biologique n’est pas disponible sur le marché, des matériaux de litière provenant de cultures non issues du génie génétique et exempts de substances interdites depuis au moins 60 jours avant la récolte peuvent être utilisés; les matériaux absorbants de sources non agricoles (par exemple, les minéraux, la cellulose, la sciure et les copeaux de bois) peuvent être utilisés pour la litière des animaux d’élevage à condition qu’ils satisfassent aux exigences énoncées en 1.4 et 1.5 et ne contiennent pas, ou n’aient pas été traités, avec des substances interdites;
- des bâtiments avec planchers antidérapants. Le couvre-plancher massif est privilégié. Le plancher ne doit pas être construit entièrement en caillebotis ou en grillage là où des planchers sur caillebotis antidérapants sont installés. La structure des planchers doit assurer que le pied du plus petit animal ne puisse pas être pris dans le vide. Les aires entre les vides doivent égaler au moins la largeur des pieds des animaux;
- les animaux qui donnent naissance à l’intérieur doivent avoir un espace suffisamment grand, propre, sec, recouvert d’une bonne litière sur une surface stable. Le bâtiment où a lieu la mise bas doit permettre la séparation des autres animaux et convenir aux besoins de la mère, incluant l’allaitement et la traite, jusqu’à ce que la mère récupère de la mise bas. Les animaux ne doivent pas être attachés lors de la mise bas;
- l’aménagement et la gestion des pâturages et des aires d’exercice extérieures doivent viser à encourager et, si possible, prolonger leur utilisation adéquate tout en prévenant l’inconfort des animaux, et à prévenir la dégradation du sol, de même que les dommages à long terme à la végétation et la contamination de l’eau.
6.7.2 L’accès aux aires extérieures et la liberté de mouvement peuvent être restreints pour les raisons suivantes, à condition que le confinement soit temporaire :
- mauvais temps;
- conditions pouvant menacer la santé ou la sécurité des animaux d’élevage selon leur stade de production; et
- la qualité du sol, de l’eau ou des plantes serait compromise.
L’exploitant doit documenter les raisons et la durée du confinement ainsi que les mesures prises pour que l’accès à l’extérieur soit moins restreint dans des circonstances qui sont sous son contrôle.
6.7.3 Il est interdit d’attacher continuellement les animaux d’élevage. Il y a une exception pour les vaches laitières selon les conditions énoncées en 6.12.1.
6.7.4 Le logement, les enclos, les aires d’exercice, l’équipement et les ustensiles doivent être nettoyés et désinfectés adéquatement afin de prévenir les risques d’infection et le développement d’organismes porteurs de maladies. Les produits de nettoyage et de désinfection répertoriés aux tableaux 5.3, 7.3 et 7.4 de la norme CAN/CGSB-32.311 doivent être utilisés. Si ces substances sont inefficaces, d’autres nettoyants et désinfectants sont permis sur recommandation d’un vétérinaire, qui confirmera également l’existence d’un problème sanitaire. En cas de maladie à déclaration obligatoire, on peut utiliser n’importe quel désinfectant nécessaire au nettoyage du logement, des enclos et des aires d’exercice. Ces utilisations doivent être documentées. Pour l’équipement en contact avec des aliments, les exigences énoncées en 8.2 s’appliquent et les substances énumérées aux tableaux 7.3 et 7.4 de la norme CAN/CGSB-32.311 sont permises.
6.7.5 Tous les animaux d’une même unité de production doivent être élevés sous régie biologique. Les animaux individuels de statut non biologique peuvent faire partie de l’unité de production s’ils sont clairement identifiés et élevés sous régie biologique. Des unités de production d’animaux d’élevage non biologiques peuvent être présentes sur une exploitation agricole, pourvu qu’elles soient clairement identifiées et maintenues séparées des unités de production d’animaux d’élevage biologiques.
6.7.6 Les animaux d’élevage biologiques peuvent paître avec des animaux non biologiques sur une même terre, soit des pâturages de la Couronne ou des pâturages communautaires, pourvu qu’il soit documenté que :
- la terre n’a pas été traitée avec des produits interdits pendant au moins 36 mois;
- les soins de santé et les aliments fournis aux animaux biologiques lorsqu’ils paissent sur une terre commune sont conformes à la présente norme;
- l’identification permette de distinguer clairement les animaux d’élevage biologiques et les animaux non élevés sous régie biologique.
6.7.7 Pour la construction de nouvelles installations, ou la rénovation d'installations, le bois destiné aux étables et aux abris peut être traité avec des substances interdites à condition que le bétail ou les aliments n’entrent pas en contact avec le bois. Dans le cas d’étables et d’abris non conformes existants, les exploitants doivent prendre des mesures afin d’empêcher tout contact avec le bois, en installant par exemple une barrière ou une zone tampon. Si des rénovations majeures sont nécessaires afin de rendre les installations existantes conformes à la norme les exploitants auront jusqu'en décembre 2023 pour exécuter ces travaux. Pour les poteaux de clôture, voir le paragraphe 5.2.3.
6.8 Gestion des déjections animales
6.8.1 La gestion des déjections animales dans les zones où les animaux d’élevage sont logés, mis en enclos ou en pâturage, doit être faite de manière à minimiser la dégradation des sols et de l’eau.
6.8.2 Toutes les installations d’entreposage et de manutention des déjections animales, y compris les installations de compostage, doivent être conçues, construites et exploitées de manière à prévenir la contamination des eaux souterraines et des eaux de surface. Voir aussi 5.5.2.
6.9 Préparation des produits des animaux d’élevage biologiques
Les articles 8.1 et 8.2 s’appliquent là où sont préparés les produits des animaux d’élevage biologiques, par exemple, dans une salle de traite en production laitière.
6.10 Lutte contre les organismes nuisibles dans les installations d’élevage
L'article 8.3 s’applique aux pratiques de lutte antiparasitaire dans les installations d’élevage et autour de celles-ci.
6.11 Exigences supplémentaires pour les bovins, les moutons et les chèvres
6.11.1 Les herbivores doivent avoir accès au pâturage pendant la saison de pâturage. En d’autres temps, y compris pendant l’étape de finition, ils doivent avoir accès à l’air libre ou à des aires d’exercice extérieures si les conditions climatiques le permettent. Des exceptions à l’exigence relative aux pâturages sont admises :
- pour les mâles reproducteurs;
- pour les jeunes animaux, quand il peut être démontré que leur santé et leur bien-être sont menacés.
6.11.2 Les exigences minimales relatives aux espaces intérieurs et extérieurs pour les bovins sont indiquées aux tableaux 1 (bovins laitiers) et 2 (bovins de boucherie) ci-après :
| Bovins laitiers | Espace intérieur | Aires d’exercice et enclos extérieurs |
|---|---|---|
| Stabulation libre | Le ratio vaches/stalle ne doit pas dépasser 1:1 | Aucune aire minimale requise |
| Étables sur litière accumulée | 11 m2 (118 pi2)/tête (de surface avec litière) | aucune aire minimale requise |
| Parcs de vêlage individuels |
15 m2 (161 pi2)/tête (de surface avec litière) | Ne s’applique pas |
| Parcs de vêlage collectifsnote 2 du tableau 1 | 11 m2 (118 pi2)/tête (de surface avec litière) | Ne s’applique pas |
| Veaux et jeunes bovins | 2,5 m2 (27 pi2)/tête pour les veaux; augmentant à 5 m2 (54 pi2)/tête pour les bouvillons et les génisses (12 mois) en croissance | 5 m2 (54 pi2)/tête à 9 m2 (97 pi2)/tête, selon la taille des animaux |
| Étables à stabulation entravée (voir 6.12.1) | Grandeur de la stalle proportionnelle à la taille de la vache | 6,5 m2 (70 pi2)/tête au printemps et à l’automne quand les vaches ne sont pas au pâturage |
Notes du tableau 1
|
||
| Bovins | Espace intérieur (lorsque fourni) | Aires d’exercice et enclos extérieurs |
|---|---|---|
| Vaches de boucherie adultes | 5,6 m2 (60 pi2) /tête pour des vaches de 500 kg (1 102 lb) augmentant à 7,25 m2 (78 pi2)/tête pour des vaches de 900 kg (1 984 lb) (surface avec litière) | 9 m2 (97 pi2)/tête |
| Bovins en phase de finition | Le confinement à l’intérieur est interdit pendant la saison de pâturage. Mêmes exigences d’espace que les veaux et jeunes bovins |
23 m2 (247,5 pi2)/tête pour des bêtes en finition de 363 kg (800 lb) augmentant à 46,5 m2 (500 pi2)/tête pour des bêtes en finition de 545 kg (1 200 lb) |
| Veaux et jeunes bovins | 2,5 m2 (27 pi2)/tête pour les veaux; augmentant à 5 m2 (54 pi2)/tête pour les bouvillons et les génisses (12 mois) en croissance (de surface avec litière) | 5 m2 (54 pi2)/tête à 9 m2 (97 pi2)/tête, selon la taille des animaux |
| Parcs de vêlagenote 1 du tableau 2 |
13,4 m2 (144 pi2)/tête (de surface avec litière) | Ne s’applique pas |
Notes du tableau 2
|
||
6.11.3 Logement des moutons et des chèvres
Les exigences minimales relatives aux espaces intérieurs et extérieurs pour les moutons et les chèvres sont indiquées au tableau 3.
| Moutons et chèvres | Espace intérieur | Aires d’exercice et enclos extérieurs |
|---|---|---|
| Brebis chèvres et agneaux/chevreaux allaités | 1,2 m2 (21,5 pi2)/tête plus 0,35 m2 (3,8 pi2)/tête pour chaque agneau ou chevreau | 3 m2 (32,3 pi2)/tête plus 0,5 m2 (5,4 pi2)/tête pour chaque agneau ou chevreau |
| Agneaux ou chevreaux sevrés ou nourris au biberon | 0,5 m2 (5,4 pi2)/tête passant à 1,5 m2 (16 pi2)/tête pour les agneaux et chevreaux d’un an | 0,75 m2 (8,1 pi2)/tête passant à 2,25 m2 (24 pi2)/tête pour les agneaux et chevreaux d’un an |
| Béliers et boucs âgés de plus d'un an | 3 m2 (32,3 pi2)/tête | 4,5 m2 (48,5 pi2)/tête |
Si la construction d’une nouvelle infrastructure est requise pour se conformer à 6.11.3, les exploitants bénéficient d’une exemption leur permettant d’utiliser les infrastructures existantes jusqu’à la fin de décembre 2025, à la condition qu’un plan pour la nouvelle construction ou rénovation soit mis en place au plus tard en décembre 2023.
6.12 Exigences supplémentaires pour le logement des bovins laitiers
6.12.1 Les stalles entravées dans les étables à vaches laitières existantes peuvent être utilisées pour les vaches en lactation et pendant une période d’un mois pour l’entraînement des génisses élevées en stabulation libre. Les stalles entravées sont interdites dans les étables nouvellement construites et pour celles qui subissent des rénovations majeures. Les stalles entravées seront progressivement éliminées de la production laitière biologique d’ici décembre 2030. À partir de décembre 2020, lorsque les vaches laitières sont gardées en stalles entravées, une période d’exercice doit être prévue au moins deux fois par semaine, de préférence tous les jours.
6.12.2 Dans une étable à stabulation libre à logettes, le ratio vaches/stalles ne doit pas dépasser 1:1
6.12.3 Les dresseurs électriques sont interdits. Les queues des vaches logées dans les stalles peuvent être attachées pour éviter que la queue traîne dans le caniveau, à condition que cette pratique permette une liberté de mouvement de la queue, un dégagement rapide au besoin et l’adoption de comportements normaux.
6.12.4 Dans les salles de traite :
- les exploitants doivent minimiser le temps d’attente des animaux depuis le moment où ils sont amenés dans l’aire d’attente jusqu’au moment où ils retournent à l’étable ou au pâturage;
- les unités de traite portatives doivent être disponibles pour les animaux trop malades ou trop faibles pour se rendre à la salle de traite;
- les barrières électriques sont interdites;
- l’aire d’attente, la salle de traite et les allées doivent être dotées de planchers antidérapants.
6.12.5 Les veaux peuvent être logés dans des enclos et des logettes individuels jusqu’à l’âge de trois mois si les conditions suivantes sont respectées :
- ils ne sont pas attachés et disposent de suffisamment d’espace pour se retourner, se coucher, s’étirer lorsqu’ils sont couchés, se lever, se reposer et faire leur toilette;
- les enclos individuels doivent être conçus et situés de façon à ce que chaque veau puisse voir, sentir et entendre les autres veaux;
- les aires de logement individuelles doivent mesurer au moins 2,5 m2 (27 pi2) et avoir une largeur minimale de 1,5 m (4.9 pi);
- les logettes installées à l’extérieur doivent procurer l’accès à un enclos ou à un parcours fermé.
6.12.6 Les veaux doivent être logés en groupe après le sevrage.
6.12.7 Selon la saison, les veaux de race laitière de plus de neuf mois doivent avoir accès au pâturage.
6.13 Exigences supplémentaires pour l’élevage de volaille
6.13.1 L’exploitant d’un élevage de volaille biologique doit mettre en place et maintenir des conditions d’élevage adaptées à la santé et au comportement naturel des volailles :
- L’élevage de volaille dans des cages en rangées, en batteries, aménagées ou en colonie est interdit;
- Les volailles doivent être élevées en liberté et avoir librement accès à des pâturages, à des aires d’exercice extérieures ou à d’autres aires d’exercice en fonction du climat et de l’état du sol. Les aires extérieures doivent :
- être exemptes de substances interdites 36 mois avant d’être utilisées;
- être recouvertes de végétation (ensemencées au besoin) et périodiquement inutilisées pour permettre la croissance de la végétation et prévenir l’accumulation d’organismes pathogènes. Un périmètre sans végétation peut être créé autour des poulaillers pour contrôler les rongeurs;
- fournir un couvert aérien fonctionnel (pour l’ombre et la protection contre les prédateurs aviaires) réparti sur toute la surface du parcours des pondeuses élevées en poulailler de manière à encourager son utilisation continue par les oiseaux; le couvert peut être naturel (arbres, arbustes et cultures) ou artificiel (toiles à ombrer, filets de camouflage, écrans ou remorques, par exemple). Les avant-toits au-dessus du pâturage peuvent constituer jusqu’à 50 % du couvert aérien requis s’ils sont fonctionnels (s’ils fournissent de l’ombre et une protection contre les prédateurs aviaires). D’ici décembre 2023, les exploitants sont tenus de soumettre un plan pour garantir que le couvert aérien représentera en décembre 2025 au moins 10 % de la surface minimale requise pour le parcours (telle que décrite au tableau 5 de 6.13.13);
- être visiblement utilisées de manière appropriée selon les saisons.
- L’accès aux aires extérieures peut être restreint en situation d’urgence, s’il constitue une menace imminente à la santé et au bien-être des volailles. L’accès aux aires extérieures doit être rétabli lorsque la menace imminente est écartée. Les producteurs doivent documenter les périodes de confinement;
- Les exploitants doivent avoir un plan biologique qui décrit l’accès aux aires extérieures et explique comment les volailles seront protégées contre la maladie et les prédateurs.
6.13.2 Exigences générales pour les pondeuses
- Les pondeuses peuvent être confinées durant le début de la ponte, jusqu’à ce que le sommet de production soit atteint. Les poules pondeuses doivent avoir accès aux zones extérieures durant une période équivalant à au moins un tiers de leur vie;
- Il est recommandé que les conditions prévalant dans les installations d’élevage correspondent étroitement à celles qui existent dans le poulailler à pondeuses. Les poulettes, par contre, peuvent être gardées à l’intérieur jusqu’à ce qu’elles soient entièrement immunisées;
- Les troupeaux de pondeuses doivent être limités à 10 000 oiseaux. Plus d’un troupeau peut être logé dans le même bâtiment pourvu que les troupeaux soient séparés et qu’ils aient des aires extérieures séparées.
6.13.3 Vérandas aménagées pour les pondeuses élevées en poulailler
- Les vérandas aménagées doivent être utilisées lorsque les pondeuses élevées en poulailler n’ont pas accès aux aires extérieures à cause de contraintes météorologiques ou sanitaires (présence de maladies);
- Une véranda aménagée est une extension couverte, non isolée et non chauffée ajoutée à un poulailler. Les oiseaux ont accès à la véranda tout au long de l'année, pendant la journée, au moins du printemps à l'automne. La véranda aménagée doit :
- offrir un climat extérieur, mais assurer une protection contre les intempéries (par exemple, le vent, la pluie), les rongeurs, les prédateurs et les menaces de maladies;
- représenter au moins 1/3 de la superficie au sol de l’intérieur du poulailler;
- avoir un éclairage naturel, qui peut être complété par un éclairage artificiel;
- avoir un sol en sable ou en terre battue; ou un sol solide recouvert de litière, telle que de la paille ou des copeaux de bois, pour le confort et la chaleur, et pour encourager les comportements de recherche de nourriture, de grattage et de bain de poussière;
- offrir des enrichissements (par exemple, des perchoirs, des plateaux de verdure, des balles de foin, des objets à picorer) pour encourager les comportements naturels;
- ne pas être incluse dans le calcul des superficies des aires intérieures et extérieures.
- Des vérandas aménagées doivent être prévues dans les nouvelles constructions pour les pondeuses élevées en poulailler. Des vérandas aménagées doivent être ajoutées aux infrastructures existantes lorsque l’exploitant ne peut pas démontrer qu'au moins 25 % des pondeuses utilisent le parcours extérieur lorsqu’il n’y a aucune contrainte météorologique ou sanitaire;
- Toutes les vérandas aménagées déjà existantes en la date du mois de décembre 2020 sont acceptées telles quelles et 6.13.3 b 2 et 6.13.3 b 6 ne s’appliquent pas;
- Si l’exploitant peut démontrer que l'ajout d'une véranda aménagée conforme à 6.13.3 b n'est pas possible à cause d’un manque d'espace ou en raison des limites de la structure du poulailler existant :
- il est permis d’aménager une véranda plus petite à la condition que ses dimensions soient aussi près que possible du tiers (⅓) de la superficie du poulailler, ou
- la véranda aménagée doit être érigée dans l’aire extérieure existante non couverte et, par exception, sa superficie serait incluse dans le calcul de la superficie de l’aire extérieure, ou
- les exploitants bénéficient d'une exemption qui permet l'utilisation de l'infrastructure existante jusqu'en décembre 2030, à la condition qu'un plan pour la nouvelle construction ou la rénovation de l’infrastructure existante soit fourni avant décembre 2025.
6.13.4 Les poules pondeuses doivent avoir accès à un nombre adéquat de nids, conformément aux pratiques de gestion exemplaires recommandées.
6.13.5 Les perchoirs doivent satisfaire aux critères suivants :
- Dès les premières semaines de vie, les poussins de pondeuses doivent avoir constamment accès à un perchoir;
- Pendant la phase d’élevage des poulettes, l’espace de perchoir adéquat doit convenir au système de production final et demeurer accessible à différentes hauteurs en tout temps;
- Les pondeuses doivent disposer d’un espace de perchoir d’au moins 15 cm (5,9 po) par oiseau, accessible à différentes hauteurs et en tout temps;
- Les perchoirs destinés aux pondeuses doivent être spécifiquement conçus à cette fin, tels que des rails d’atterrissage dans les volières qui permettent aux oiseaux d’encercler les rails avec leurs orteils. Les rebords des mangeoires et des abreuvoirs, les caillebotis et les barreaux d’échelle ne sont pas considérés comme des structures expressément conçues pour le perchage, mais ils peuvent offrir de l’espace de perchoir additionnel, au-delà de ce qui est requis aux alinéas 6.13.5 a, 6.13.5b et 6.13.5c;
- Le diamètre ou la largeur des perchoirs doit être d’au moins 1,9 cm (0,75 po);
- Les autres volailles ne sont pas assujetties aux alinéas 6.13.5 a, 6.13.5b, 6.13.5c, 6.13.5d et 6.13.5e.
Remarque
Les producteurs ont tout intérêt à consulter le Code de pratiques pour le soin et la manipulation des poulettes et pondeuses (voir 2.4) afin de s’assurer qu’ils respectent bien les exigences de perchoirs supplémentaires de ce code pour les poulettes et les pondeuses adultes.
6.13.6 Exigences générales pour les poulets à griller et les dindons :
- Les poulets à griller élevés à l’extérieur sans accès aux aires intérieures doivent avoir accès à des pâturages quotidiennement dès l’âge de quatre semaines, sauf si les conditions météorologiques mettent leur santé et leur sécurité en danger. Les dindons doivent avoir accès aux aires extérieures à l’âge de huit semaines;
- Les poulets à griller élevés en poulailler doivent avoir un accès quotidien à l'extérieur dès l'âge de 25 jours lorsqu’il n’y a pas de contraintes météorologiques. Les exploitants doivent prendre des mesures pour augmenter l'utilisation des pâturages et des aires d'exercice extérieures avec, comme objectif, qu'au moins 15 % des oiseaux se trouvent à l’extérieur lorsqu'il n'y a aucune contrainte climatique. Les exploitants doivent documenter l’utilisation des aires extérieures et chercher à augmenter le nombre d’oiseaux qui les utilisent dans les années à venir. Ces dispositions seront révisées d’ici décembre 2025.
Remarque
Mesures potentielles pour accroître l’utilisation des pâturages et aires d’exercice extérieures :
- utiliser des races rustiques à croissance plus lente (caractérisées par un taux de croissance ne dépassant pas 45 g/jour);
- utiliser une ration ajustée sur le plan nutritionnel pour engendrer une croissance plus lente (c.-à-d., plus faible en protéines);
- abattre les oiseaux à un âge plus avancé (p. ex., 60 jours), si leur santé peut être préservée;
- permettre l'accès à l'extérieur avant l'âge minimum spécifié;
- fournir des unités mobiles pour la production estivale;
- fournir un couvert aérien efficace dans les pâturages;
- enrichir les pâturages (nourriture, eau, perchoirs, etc.);
- améliorer l'accès aux pâturages (changements au niveau des issues);
- établir des vérandas aménagées (décrites à 6.13.3 b).
6.13.7 Les poulaillers doivent bénéficier d’issues suffisantes pour que tous les oiseaux aient un accès facile à l’extérieur.
6.13.8 Les issues doivent :
- permettre le passage d’un ou de plusieurs oiseaux à la fois et être également distribuées le long du mur d’accès au parcours extérieur;
- correspondre aux exigences indiquées au tableau 4 quant au nombre et à la grandeur des issues :
| Volaille | Largeur totale des issues | Largeur minimale de chaque issue | Hauteur minimale | Nombre minimal |
|---|---|---|---|---|
| Pondeuses | 2 m (6,6 pi) /1 000 poules | 50 cm (20 po) | 35 cm (14 po) | 2 |
| Poulets à griller | 1 m (3,3 pi) /1 000 oiseaux OU tous les oiseaux à 15 m (49 pi) ou moins d’une issue | 50 cm (20 po) | 35 cm (14 po) | 2 |
| Dindes | 2 m (6,6 pi)/1 000 oiseaux | 150 cm (59 po) | 75 cm (30 po) | 2 |
6.13.9 Lorsque des fermes aviaires biologiques existantes ne respectent pas les exigences de 6.13.8 b) (tableau 4), la distance d’accès à une issue ne doit pas excéder 15 m (49 pi) en tout point du poulailler, ou bien l’exploitant doit prouver que les oiseaux utilisent le parcours extérieur. Ces preuves doivent démontrer qu’un minimum de 25 à 50 % des oiseaux est sur le parcours extérieur lorsqu’il n’y a aucune contrainte relative à l’âge ou aux conditions météorologiques.
6.13.10 De la litière maintenue sèche doit être fournie comme substrat pour les déjections animales. Dans les bâtiments dotés de caillebotis, une superficie d’au moins 30 % des planchers doit être constituée de plancher massif recouvert de litière pour encourager des comportements tels que les bains de poussière, le grattage et la recherche de nourriture.
6.13.11 Les installations doivent permettre aux volailles d’accéder au nombre minimal d’abreuvoirs et de mangeoires exigé par le code de pratiques en vigueur (voir 2.4).
6.13.12 Lorsqu’elles sont à l’intérieur, les volailles doivent bénéficier de la lumière naturelle grâce à des fenêtres réparties uniformément ou à des matériaux qui laissent passer la lumière. La superficie totale des fenêtres doit représenter au moins 1 % de la superficie totale au sol, à moins qu’il soit démontré que la quantité de lumière naturelle en tout point du poulailler est suffisante pour que l’on puisse y lire un document tel un journal. Si la lumière du jour est artificiellement prolongée, la durée totale du maintien de la luminosité ne doit pas excéder 16 h, et doit se terminer par la réduction graduelle de l’intensité lumineuse; une séquence d’obscurité continue de 8 h doit s’ensuivre. Les exceptions suivantes sont permises et doivent être documentées :
- une hausse de l’intensité de l’éclairage est temporairement permise selon l’étape de production, comme, par exemple, lors de l’arrivée de poussins et de dindonneaux;
- la diminution de l’intensité de l’éclairage est permise si le bien-être animal devient préoccupant, quand surviennent, par exemple, des éclosions de cannibalisme.
6.13.13 Les densités maximales dans les aires intérieures et extérieures sont indiquées au tableau 5
| Volailles | Aires intérieures | Aires extérieures |
|---|---|---|
| Pondeuses | 6 oiseaux/m2 (10,76 pi2) | 4 oiseaux/m2 (10,76 pi2) |
| Poulettes âgées de 0 à 8 semainesnote b du tableau 5 | 24 oiseaux/m2 (10,76 pi2) | 16 oiseaux/m2 (10,76 pi2) |
| Poulettes âgées de 9 à 18 semainesnote b du tableau 5 | 15 oiseaux/m2 (10,76 pi2) | 10 oiseaux/m2 (10,76 pi2) |
| Poulets à griller | 21 kg/m2 (4,3 lb/pi2) | 21 kg/m2 (4,3 lb/pi2) |
| Dindeons/gros oiseaux | 26 kg/m2 (5,3 lb/pi2) | 17 kg/m2 (3,5 lb/pi2) |
Notes du tableau 5
|
||
6.13.14 Les systèmes aviaires multiniveaux pour les élevages de pondeuses doivent compter au plus trois niveaux au-dessus du sol. L’espace de plancher total, aux fins du calcul de la superficie de plancher solide et de la densité des oiseaux, doit inclure l’ensemble des niveaux de plancher utiles (voir 6.13.10 et 6.13.13). Si elles sont utilisées pour fournir un espace de grattage, les vérandas aménagées doivent être accessibles à longueur d’année.
6.13.15 Pour les exploitations sur pâturage dotées d’unités mobiles, la densité de chargement ne doit pas dépasser 2 000 poules pondeuses par hectare (800 par acre), 2 500 poulets à griller par hectare (1 000 par acre) ou 1 300 gros oiseaux (dindons/oies) par hectare (540 par acre); la superficie totale inclut l’ensemble des terres utilisées en rotation pour le pâturage de la volaille. Les abris temporaires mobiles où logent les oiseaux doivent être déplacés quotidiennement, si possible, et au moins une fois tous les quatre jours, compte tenu des effets sur les oiseaux et sur les terres. La densité à l’intérieur des abris mobiles doit correspondre aux densités des aires intérieures indiquées en 6.13.13.
6.13.16 Les bâtiments doivent être vidés, nettoyés et désinfectés entre les différents troupeaux d’élevage, et les aires d’exercice temporairement inutilisées pour permettre à la végétation de repousser entre les élevages.
6.13.17 Les canards et les oies doivent avoir accès à un bassin d’eau créé pour leur usage, lorsque les conditions météorologiques le permettent. Les installations doivent être conçues de manière à prévenir le regroupement de sauvagines et de volailles domestiques.
6.14 Exigences supplémentaires pour les lapins
6.14.1 Les lapins peuvent être temporairement confinés dans des cages ou des clapiers si une telle mesure est nécessaire pour assurer leur confort et leur sécurité (par exemple, pendant la nuit). Le confinement permanent est interdit.
6.14.2 L’utilisation d’enclos mobiles dans le pâturage est permise, pourvu que les enclos ne fassent pas obstacle aux comportements normaux des lapins et qu’ils soient déplacés au moins une fois tous les trois jours.
6.14.3 Les lapins doivent disposer de l’espace nécessaire pour courir, sauter, creuser et s’asseoir sur leurs pattes de derrière, les oreilles dressées. Les exigences minimales visant les espaces intérieurs et extérieurs sont indiquées au tableau 6.
| Lapins | Espace intérieur | Aires extérieures / parcours et aires bétonnées | Pâturage extérieur | Enclos mobiles |
|---|---|---|---|---|
| Du sevrage à l’abattage | 0,3 m2 (3,23 pi2)/tête | 2 m2 (22 pi2)/tête | 5 m2 (54 pi2)/tête | 0,4 m2 (4,3 pi2)/tête |
| Hases en gestation | 0,5 m2 (5,4 pi2)/tête | 2 m2 (22 pi2)/tête | 5 m2 (54 pi2)/tête | 0,5 m2 (5,4 pi2)/tête |
| Hases et portée | 0,7 m2 (7,5 pi2) | 2 m2 (22 pi2) | Sans objet | 0,4 m2 (4,3 pi2)/tête pour une aire abritée 2,4 m2 (26 pi2)/tête pour une aire de pâturage |
| Lapins mâles | 0,3 m2 (3,23 pi2)/tête | 2 m2 (22 pi2)/tête | 5 m2 (54 pi2)/tête | 0,4 m2 (4,3 pi2)/tête |
6.14.4 Les lapins ne doivent pas être soumis à un éclairage continu ou gardés constamment dans l’obscurité. De jour, les lapins doivent être en mesure de distinguer leur environnement et de se voir clairement entre eux.
6.14.5 Il faut fournir aux hases sur le point de mettre au monde des boîtes ou des terriers isolés pour la mise bas.
6.14.6 La hase et sa portée doivent avoir libre accès aux parcours extérieurs et aires de fourrage une fois que les lapereaux ont atteint l’âge de 21 jours.
6.14.7 Le sevrage des lapereaux âgés de moins de 30 jours est interdit. Cependant, un sevrage hâtif est permis si le bien-être de la hase ou des lapereaux est compromis.
6.15 Exigences supplémentaires pour les porcs et sangliers élevés à la ferme
6.15.1 Le nombre d’animaux dans les unités de production doit être proportionnel aux terres détenues, louées ou disponibles pour l’épandage du fumier, suivant un équilibre entre les unités animales, la production d’aliments pour les nourrir et la gestion des déjections animales. Les exploitations de naissage-engraissage ne doivent pas dépasser 2,5 truies/ha (1 truie/acre).
6.15.2 Tous les porcs, à l’exception des truies qui allaitent leurs porcelets, doivent avoir accès à des aires d’exercice extérieures. L’accès aux aires extérieures peut être temporairement restreint, tel qu’énoncé en 6.7.2.
- Ces aires extérieures peuvent inclure des terrains boisés ou d’autres environnements naturels ainsi que des aires d’exercice sur sol ou sur béton. L’accès au pâturage est recommandé, mais pas obligatoire. Lorsque les aires de pâturage sont dégradées et ne peuvent pas être utilisées, les porcs doivent avoir accès à d’autres aires d’exercice afin de répondre aux exigences relatives à l’accès à des aires extérieures et permettre aux animaux de fouir;
- Une aire d’exercice extérieure peut être couverte, pourvu qu’au moins trois côtés de la structure soient ouverts;
- Lorsqu’ils sont à l’extérieur dans des aires ouvertes (p. ex., au pâturage), les porcs doivent avoir accès à un abri ou un lieu ombragé pouvant accueillir le troupeau au complet afin qu’ils puissent se mettre à l’abri par mauvais temps;
- Les porcs ne doivent pas être confinés exclusivement aux aires sur béton sans accès à un espace intérieur ou extérieur recouvert de litière;
- Les directives relatives à la gestion des aires extérieures (6.7.1), à la prévention de l’apparition et de la propagation de parasites (6.6.1 c, 6.6.11), et qui permettent aux porcs de fouir (6.15.7) s’appliquent.
Remarque
Les pratiques de gestion des pâturages mises en place pour prévenir la dégradation du sol et l’accumulation de parasites peuvent comprendre :
- la rotation des pâturages avec des cultures annuelles;
- un plan de rotation des enclos selon la saison;
- l’inoccupation d’un enclos pendant 5 ans avant de le repeupler de porcs en croissance; et
- l’utilisation d’un enclos pour les truies pour un maximum de 2 ans avant de laisser l’enclos inoccupé pour une période de temps.
6.15.3 Les truies et les jeunes truies doivent être gardées en groupe, sauf dans les cas suivants :
- les enclos individuels sont permis pour la protection des femelles durant l’œstrus, ou pour d’autres raisons liées à la santé, pour une période pouvant atteindre cinq jours;
- les truies peuvent être logées individuellement dans un enclos (7,5 m2 [81 pi2] par truie avec portée) jusqu’à cinq jours avant la date prévue de mise bas et pendant la période d’allaitement sous la mère;
- pendant la période d’allaitement sous la mère, la restriction du mouvement des truies est permise pour un maximum de trois jours pour protéger au besoin les porcelets, ou pour une période plus courte pour assurer la sécurité de l’exploitant pendant le traitement des porcelets ou le nettoyage de l’enclos;
- l’utilisation de stalles de mise bas pour restreindre le mouvement est interdite.
6.15.4 Les porcelets ne doivent pas être sevrés avant l’âge de quatre semaines. Un sevrage précoce est autorisé si le bien-être de la truie et des porcelets est compromis.
6.15.5 Les porcelets ne peuvent pas être gardés sur des plates-formes ou en cages.
6.15.6 Les verrats peuvent être logés dans des enclos individuels s’il y a un contact visuel et tactile avec d’autres porcs.
6.15.7 Les aires d’exercice intérieures et extérieures doivent permettre aux animaux de fouir.
6.15.8 L’utilisation des anneaux nasaux est interdite.
6.15.9 Les exigences minimales visant les espaces intérieurs et extérieurs sont indiquées au tableau 7.
| Porcs et sangliers | Espace intérieur | Aires d’exercice et enclos extérieurs |
|---|---|---|
| Truie et porcelets (de 40 jours ou moins) | 7,5 m2 (81 pi2) pour chaque truie et sa portée | Non requis |
| Porcs en croissance
|
0,6 m2 (6,5 pi2)/tête 0,8 m2 (8,6 pi2)/tête 1,1 m2 (12 pi2)/tête 1,3 m2 (14 pi2)/tête |
0,4 m2 (4,3 pi2)/tête 0,6 m2 (6,5 pi2)/tête 0,8 m2 (8,6 pi2)/tête 1,0 m2 (10,76 pi2)/tête |
| Truies en enclos de groupe | 3 m2 (32,3 pi2)/tête | 3 m2 (32,3 pi2)/tête |
| Sangliers en enclos individuels | 9 m2 (97 pi2)/tête | 9 m2 (97 pi2)/tête |
Notes du tableau 7
|
||
7 Exigences propres à certaines productions
7.1 Apiculture
7.1.1 Un exploitant peut introduire des abeilles dans son exploitation pour en améliorer la production par la pollinisation de ses cultures biologiques. Si elles sont considérées comme une espèce d’élevage donnant des produits apicoles biologiques (par exemple, miel, pollen, propolis, gelée royale, cire d’abeille et venin d’abeille), les abeilles doivent être élevées conformément à la présente norme.
7.1.2 L’exploitant doit préparer un plan de production biologique (voir 4.1, 4.2 et 4.3) qui décrit en détail la provenance des abeilles, les méthodes de production, le régime alimentaire, le contrôle des ravageurs incluant les maladies, les acariens et les insectes, la reproduction et les autres problèmes connexes de gestion des colonies. L’exploitant doit également décrire les pratiques de gestion des cultures, le cas échéant.
7.1.3 Les registres doivent être mis à jour et documenter toutes les activités de gestion du rucher, y compris le retrait des hausses et l’extraction du miel (voir 4.4).
7.1.4 Le traitement et la gestion des colonies doivent respecter les principes de la production biologique (voir Introduction, article 0.2).
7.1.5 Les principales sources de nectar, de miellat et de pollen doivent provenir de plantes biologiques et de végétation sauvage spontanée. Les cultures génétiquement modifiées ou traitées avec des substances interdites doivent être évitées.
7.1.6 La gestion de la santé des abeilles doit être fondée sur des mesures appropriées telles que la sélection de colonies résistantes aux maladies, la disponibilité d’aires de butinage appropriées et les bonnes pratiques de gestion des ruchers.
7.1.7 Lorsque les abeilles sont placées dans des zones sauvages, il faut tenir compte de l’impact sur les populations d’insectes indigènes.
7.1.8 Conversion
7.1.8.1 Les colonies et les ruches (y compris les supercadres de couvain et de miel) doivent être soumises à une gestion biologique continue pendant au moins 12 mois avant d’être considérées comme étant biologiques.
7.1.8.2 Les colonies et les ruches ne doivent pas être soumises en alternance à des systèmes de gestion biologique et non biologique. Les abeilles traitées avec des antibiotiques sont assujetties aux exigences énoncées en 7.1.15.7.
7.1.9 Abeilles de remplacement
Les abeilles introduites, soit les abeilles de remplacement dans les colonies établies, doivent être biologiques lorsqu’elles sont disponibles sur le marché. Les colonies de remplacement doivent être produites dans la même exploitation ou être fournies par une autre exploitation apicole biologique.
7.1.10 Emplacement des ruches
Les ruchers doivent être séparés par une zone tampon de 3 km (1,875 mi) des sources ou des zones où des substances interdites sont présentes, telles les cultures issues du génie génétique ou les contaminants environnementaux. Les exceptions suivantes s’appliquent :
- l’utilisation d’engrais, y compris ceux non listés au tableau 4.2 (colonne 2) de la norme CAN/CGSB-32.311, est permise dans la zone tampon, à l’exception des boues d’épuration; et
- la zone tampon peut être réduite si des caractéristiques naturelles telles que forêts, collines ou cours d’eau diminuent la probabilité de déplacement des abeilles et si les sources de butinage conformes sont abondantes.
7.1.11 Butinage et nourrissage
7.1.11.1 La principale source de nourriture des colonies adultes doit être le nectar et le pollen collectés auprès de sources conformes à la présente norme et les réserves de nourriture accumulées par les abeilles dans la ruche (miel, pollen, etc.).
- Lors d’une pénurie régionale ou saisonnière de sources de nourriture, ou pour le nourrissement des colonies en hiver, il est permis d’utiliser par ordre de préférence:
- Dans le cas de l'utilisation de sucre raffiné non biologique et non génétiquement modifié, l'exploitant doit :
- maintenir et documenter les pratiques appropriées pour empêcher le mélange d'aliments non biologiques et biologiques dans les hausses de miel;
- élaborer un plan visant à réduire, voire éliminer, l'utilisation de sucre raffiné non biologique dans son système de production apicole d'ici décembre 2025.
- Le nourrissement ne peut avoir lieu qu'entre la dernière récolte de miel et 15 jours avant le début de la prochaine miellée.
Remarque
Le paragraphe 7.1.11.1 sera révisé en 2025.
7.1.11.2 Aucune nourriture ne doit être fournie dans les 30 jours précédant la récolte du miel.
7.1.12 Gestion de la colonie
7.1.12.1 Les ruches doivent être individuellement et clairement identifiées et vérifiées régulièrement, c’est-à-dire à intervalles d’une ou deux semaines selon la colonie, les conditions climatiques et la période de l’année.
7.1.12.2 Il est interdit de rogner les ailes des reines.
7.1.12.3 Les abeilles doivent être retirées de la ruche au moyen d’un chasse-abeilles, d’une brosse, d’un souffleur ou par secouement.
7.1.12.4 Les matières végétales qui n’ont pas été traitées avec des substances interdites (voir 1.5) sont autorisées dans les enfumoirs d’abeilles.
7.1.12.5 La destruction annuelle des colonies d’abeilles après la miellée est interdite.
7.1.13 Fabrication de la ruche
7.1.13.1 Les ruches doivent être fabriquées et maintenues avec des matériaux naturels, comme le bois et le métal. Le bois traité sous pression ou les panneaux de particules, les produits de préservation du bois et le bois de sciage traité avec des substances interdites sont interdits.
7.1.13.2 Les surfaces extérieures de la ruche peuvent être peintes uniquement avec une peinture sans plomb.
7.1.13.3 Une fondation en plastique peut être utilisée si elle est trempée dans de la cire d’abeille biologique.
7.1.14 Soins de santé
7.1.14.1 Des pratiques de santé préventives doivent être établies et maintenues, notamment la sélection d’abeilles résistantes aux ravageurs courants, incluant les mites/acariens et les maladies; la sélection des emplacements des ruches en tenant compte des conditions du site; la disponibilité d’une quantité suffisante de pollen et de miel; le renouvellement de la cire d’abeille; la désinfection et le nettoyage réguliers de l’équipement; ainsi que la destruction des ruches et des matériaux contaminés, s’il y a lieu, pour le contrôle des parasites.
7.1.14.2 L’exploitant doit chercher à établir des colonies fortes et en santé. Les pratiques de gestion peuvent comprendre: le regroupement de colonies faibles, mais en santé; le renouvellement des reines au besoin; le maintien d’une densité adéquate dans la ruche; l’inspection systématique des colonies, et la relocalisation des colonies malades dans des endroits isolés.
7.1.15 Lutte contre les ravageurs incluant les insectes et les maladies
7.1.15.1 L’exploitant doit connaître le cycle de vie et le comportement des abeilles ainsi que les agents pathogènes, acariens parasites et autres organismes nuisibles qui les attaquent. Tous les efforts doivent être déployés pour restaurer la santé de la colonie lorsque ces organismes nuisibles sont présents.
7.1.15.2 Tous les efforts doivent être déployés pour sélectionner et élever des reines en fonction de leur résistance aux agents pathogènes et aux parasites.
7.1.15.3 La cire gaufrée doit provenir de la cire d’abeille de l’exploitation apicole ou d’autres sources biologiques lorsqu’elles sont disponibles sur le marché.
7.1.15.4 Les ravageurs (incluant les maladies) doivent être contrôlés en utilisant des méthodes de lutte ou de l’équipement modifié.
7.1.15.5 Des composés botaniques peuvent être introduits dans les ruches s’ils sont listés au tableau 5.3 de la norme CAN/CGSB-32.311, et ne sont pas utilisés dans les 30 jours précédant la miellée ou lorsque les hausses sont sur la ruche.
7.1.15.6 L’application thérapeutique de substances de contrôle des ravageurs (y compris les parasites et les maladies) est permise si ces substances sont répertoriées au tableau 5.3 de la norme CAN/CGSB-32.311.
7.1.15.7 L’utilisation de médicaments allopathiques (comme les antibiotiques) est interdite. Toutefois, en cas de risque imminent pour la santé de la colonie, l’oxytetracycline est permise (Voir Antibiotiques, oxytétracycline, dans le tableau 5.3 de la norme CAN/CGSB-32.311). Avant d’être traitées, les ruches et les colonies doivent être retirées des aires de butinage et de la production biologique pour prévenir la dissémination d’antibiotiques dans les ruches. Les ruches traitées (contenants présents pendant le traitement), y compris les abeilles présentes durant le traitement (excepté les reines), doivent être isolées et subir une période de conversion de 12 mois. La cire présente dans les ruches pendant le traitement ne doit pas être commercialisée comme biologique.
7.1.15.8 La pratique de la destruction du couvain mâle n’est autorisée que pour maîtriser une infestation de varroa.
7.1.16 Extraction, transformation et stockage
7.1.16.1 Il est interdit d’extraire du miel d’un cadre à couvain si le couvain est vivant.
7.1.16.2 La qualité et l’intégrité biologique du miel et des autres produits apicoles (voir 7.1.1) doivent être préservées et protégées, tel que prescrit en 8.1.
7.1.16.3 Les surfaces en contact direct avec le miel doivent être faites de matériaux de grade alimentaire ou recouvertes de cire d’abeille.
7.1.16.4 Le chauffage du miel à l’extraction ne doit pas dépasser 35 °C (95 °F) et la température de décristallisation ne doit pas dépasser 47 °C (116,6 °F). Le miel biologique chauffé à des températures supérieures ne peut être utilisé que comme ingrédient dans un produit multi-ingrédients.
7.1.16.5 Le dépôt par gravité doit être utilisé pour retirer les débris provenant de l’extraction du miel; les tamis sont permis pour enlever les débris résiduels.
7.1.16.6 Le miel doit être conditionné dans des contenants étanches à l’air.
7.1.16.7 Le nettoyage des installations, l’assainissement et la gestion des organismes nuisibles doivent être assujettis aux exigences énoncées en 8.2 et 8.3.
7.2 Produits de l’érable
7.2.1 Les normes relatives à la production acéricole s’appliquent également à la production de sirop d’autres types d’arbres, notamment le bouleau.
7.2.2 Les produits de l’érable biologiques doivent provenir d’unités de production régies conformément à la présente norme.
7.2.3 La présente norme s’applique à toutes les étapes de production et de préparation: entretien et aménagement de l’érablière, collecte et entreposage de l’eau d’érable et transformation de l’eau d’érable en sirop, fabrication des produits dérivés du sirop, lavage et stérilisation du matériel et entreposage des produits finis.
7.2.4 La production de sirop d’érable se caractérise par des pratiques d’aménagement respectueuses de l’érablière et de son écosystème. L’aménagement et l’entretien doivent être axés sur la préservation de l’écosystème de l’érablière et sur l’amélioration à long terme de la vigueur du peuplement.
7.2.5 Les pratiques d’entaillage doivent viser à minimiser les risques pour la santé et la longévité des arbres.
7.2.6 Le matériel et les techniques utilisés pour la collecte et l’entreposage de l’eau d’érable doivent mener à l’obtention d’un produit transformé de la meilleure qualité possible. Le matériel doit être en bon état, composé de matériaux compatibles avec la transformation alimentaire et être utilisé conformément aux instructions du fabricant.
7.2.7 Au cours de la conversion de l’eau d’érable en sirop, l’eau d’érable peut absorber toute odeur avec laquelle elle entre en contact. Il faut donc veiller tout au long de la transformation à ne pas dénaturer le produit. Il est donc interdit d’utiliser toute technologie, telle la magnétisation, susceptible d’altérer les qualités intrinsèques du produit.
7.2.8 Conversion
La présente norme doit être appliquée dans une unité de production pendant au moins 12 mois avant que la récolte d’eau d’érable soit considérée comme biologique. Les substances interdites ne doivent pas avoir été utilisées dans le boisé de l’érablière pendant au moins 36 mois précédant la première récolte. Toute production parallèle est interdite.
Remarque
La Partie 13 – Produits biologiques du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada exige que la demande de certification biologique de produits de l’érable soit présentée au moins 15 mois avant la date prévue de mise en marché.
Durant cette période, l’organisme de certification évalue le respect de toutes les exigences de la présente norme. L’évaluation doit comprendre au moins une inspection de l’unité de production, au cours de la production, dans l’année précédant le moment où les produits de l’érable peuvent devenir admissibles à la certification et une inspection dans l’année, durant la production, où les produits de l’érable sont admissibles à la certification.
7.2.9 Aménagement et entretien de l’érablière
7.2.9.1 Diversité végétale
Les exploitants doivent favoriser la diversité des espèces végétales dans l’érablière, notamment les espèces compagnes de l’érable à sucre. Les espèces compagnes de l’érable à sucre devraient représenter un minimum de 15 % du volume de bois de l’érablière et doivent donc être favorisées si elles représentent moins de 15 % de ce volume. Il est interdit d’enlever systématiquement la végétation arbustive et herbacée, même si elle est très abondante. Une coupe partielle de cette végétation est autorisée pour l’aménagement de sentiers afin de faciliter les déplacements.
7.2.9.2 Éclaircies
Lorsqu’elles sont nécessaires ou encore exigées par le gestionnaire de la forêt, les éclaircies pratiquées dans l’érablière doivent être effectuées selon les bonnes pratiques d’aménagement forestier en vigueur, tant en forêt privée qu’en forêt publique, tout en étant bien réparties sur l’ensemble de l’érablière.
7.2.9.3 Protection des arbres
L’accès à l’érablière par des animaux d’élevage qui pourraient endommager les arbres (par exemple, bovins laitiers ou bovins de boucherie, porcins ou cervidés d’élevage) est interdit afin de préserver la diversité végétale et la croissance des jeunes arbres. L’ensemble du réseau de tubulures doit être installé de façon à ne pas blesser les arbres ou nuire à leur croissance.
7.2.9.4 Fertilisation
La fertilisation doit être effectuée en suivant les recommandations fondées sur les carences observées, diagnostiquées et consignées. Les amendements de sol autorisés dans l’érablière sont la cendre de bois, la chaux agricole et les engrais mentionnés au tableau 4.2 (colonne 1) de la norme CAN/CGSB-32.311.
7.2.9.5 Lutte contre les ravageurs
La connaissance et la compréhension des mœurs des organismes nuisibles infestant l’érablière et l'équipement acéricoles et la recherche de solutions respectueuses de l’environnement sont les moyens privilégiés pour lutter contre les organismes nuisibles. À l’intérieur de l’érablière, il est permis d’utiliser les substances répertoriées au tableau 4.2 (colonne 2) de la norme CAN/CGSB-32.311 pour le contrôle des ravageurs, incluant les maladies et les insectes. Dans les installations de transformation, les pièges mécaniques et les pièges collants sont permis pour contrôler les rongeurs et les autres organismes nuisibles destructeurs, de même que les répulsifs naturels répertoriés au tableau 8.2 de la norme CAN/CGSB-32.311. S’il y a une infestation de ravageurs vertébrés, on peut avoir recours à la chasse; les poisons de toutes sortes sont interdits contre ces ravageurs.
7.2.10 Entaillage
7.2.10.1 Diamètre de l’arbre et nombre d’entailles
Le tableau 8 indique le nombre maximal d’entailles que peut porter un érable sain en fonction de son diamètre à hauteur de poitrine (D.H.P). Le D.H.P. est le diamètre de l’arbre mesuré à une hauteur de 1,3 m (4.3 pi) au-dessus du niveau du sol. Aucun érable ne peut recevoir plus de trois entailles.
| Diamètre mesuré à une hauteur de 1,3 m (4,3 pi) au-dessus du niveau du sol | Nombre maximal d’entailles |
|---|---|
| Moins de 20 cm (8 po) | 0 |
| 20 à 40 cm (8 à 16 po) | 1 |
| 40 à 60 cm (16 à 23,6 po) | 2 |
| 60 cm (23,6 po) ou plus | 3 |
7.2.10.2 Profondeur et diamètre des entailles
La profondeur maximale des entailles est fixée à 5 cm (1,9 po) sur l’écorce des arbres ayant un diamètre inférieur à 25 cm (9,8 po) et à 6 cm (2,4 po) sur l’écorce des arbres dont le diamètre est égal ou supérieur à 25 cm (9.8 po). Le diamètre des entailles ne doit pas dépasser 7,93 mm (5/16 po). Lorsqu’un arbre est malade, attaqué par des ravageurs, dépérissant ou lorsque ses entailles cicatrisent mal, la norme d’entaillage est alors plus stricte :
- il faut alors réduire à 2 le nombre d’entailles par arbre lorsque 7.2.10.1 en permet 3, et à 1 lorsqu’il en permet 2;
- il est interdit d’entailler lorsque le D.H.P. (diamètre à hauteur de poitrine) est inférieur à 25 cm (≈9 7/8 po).
Si la santé des arbres est compromise par des blessures, des insectes, une maladie ou le pourrissement, on peut se référer au tableau 8 de 7.2.10.1, tout en utilisant des chalumeaux à diamètre réduit, ou bien s’abstenir d’entailler.
7.2.10.3 Désinfection des entailles et du matériel d’entaillage
L’alcool éthylique de grade alimentaire peut être aspergé sur les chalumeaux et les mèches lors de l’entaillage, mais son aspersion est interdite dans l'entaille. Il est interdit d'appliquer tout autre germicide, tels l’alcool dénaturé (mélange d’éthanol et d’acétate d’éthyle) et l’alcool isopropylique, dans les entailles et sur le matériel d’entaillage.
7.2.10.4 Double entaillage et désentaillage
Les érables ne doivent être entaillés qu'une fois par année. Le double entaillage, soit la pratique qui consiste à réentailler un arbre déjà entaillé dans une même saison, est interdit. Tous les chalumeaux doivent être retirés des arbres au plus tard 60 jours après la dernière coulée de l’année afin de permettre à l’arbre de cicatriser. Les érables ne doivent être entaillés qu’en période de mise en opération des érablières (temps des sucres). La production de sirop d'automne est interdite.
7.2.11 Collecte et entreposage de l’eau d’érable
7.2.11.1 Chalumeaux
Les chalumeaux doivent être fabriqués de matériaux de grade alimentaire.
7.2.11.2 Collecte sous vide de l’eau d’érable
Tous les éléments du système de collecte qui entrent en contact avec l’eau d’érable doivent être constitués de matériaux compatibles avec la fabrication d’un produit alimentaire. Les pompes doivent être bien entretenues et l’huile usée récupérée et éliminée de façon à ne pas contaminer l’environnement.
Remarque
Il est recommandé de recycler l'ensemble des matériaux des éléments du système de collecte.
7.2.11.3 Entreposage
Tout le matériel qui peut entrer en contact avec l’eau d’érable ou le concentré et les filtrats, tels que les bassins d’entreposage, les raccords et les systèmes de transfert, doit être fabriqué avec des matériaux compatibles avec la transformation alimentaire. Cette règle s’applique aussi à toutes les couches de protection (comme la peinture) ainsi qu’aux soudures. L’utilisation de systèmes d’injection d’air avec soufflerie dans l’eau d’érable avant, pendant ou après sa transformation est interdite.
7.2.11.4 Collecte à partir de seaux
Les chaudières ou seaux peuvent être en aluminium ou en plastique, mais pas en acier galvanisé. Un couvercle doit être utilisé pour couvrir les seaux. Les normes relatives aux réservoirs d’entreposage s’appliquent également aux contenants servant à transporter l’eau recueillie dans les seaux.
7.2.12 Transformation de l’eau d’érable en sirop
7.2.12.1 Filtration de l’eau d’érable
L’eau d’érable doit être filtrée avant sa transformation. Cette filtration ne doit pas affecter les qualités intrinsèques de l’eau d’érable.
7.2.12.2 Stérilisation de l’eau d’érable
La stérilisation de l’eau d’érable avant sa transformation en sirop est interdite, que ce soit par traitement aux rayons ultraviolets ou par l’ajout d’un quelconque produit de stérilisation.
7.2.12.3 Osmoseur et membranes
La technique d’osmose inverse est acceptable pour la concentration de l’eau d’érable. Seules les membranes de type osmose inverse et nanofiltration (ultraosmose) sont autorisées. Durant la période d’inactivité, les membranes des osmoseurs doivent être entreposées avec du filtrat ou de l’eau potable dans un contenant hermétiquement scellé, dans un endroit où elles seront protégées du gel. Le métabisulfite de sodium (MTBS) et le métabisulfite de potassium (MTBP) peuvent être ajoutés au filtrat ou à l’eau potable pour prévenir la croissance des moisissures. En tels cas, la membrane doit alors être rincée avant le printemps suivant avec un volume d’eau équivalent à la capacité horaire de la membrane (par exemple, 2 271 L [600 gal] d’eau pour une membrane de 2 271 L/h [600 gal/h]). L’entreposage hors site de la membrane (par exemple, chez le fournisseur de membranes) doit être consigné. Les lubrifiants de grade alimentaire sont permis pour lubrifier l'équipement de production acéricole.
7.2.12.4 Évaporateur
Les cuves de l’évaporateur doivent être faites d’acier inoxydable. Les soudures doivent être faites au tungstène sous gaz inerte (TIG) ou à l’étain-argent. Les cuves en acier galvanisé, en cuivre ou en aluminium et acier étamé ne sont pas autorisées. La qualité de l’air et de l’environnement doit être contrôlée dans la salle d’évaporation. L’utilisation de systèmes d’injection d’air avec soufflerie est interdite dans les cuves d’évaporation.
7.2.12.5 Agents anti-mousse
Seuls sont autorisés les agents anti-mousse biologiques d'origine végétale qui n'ont pas été chimiquement altérés. À titre d’exemple, le bois d’érable de Pennsylvanie (Acer pennsylvanicum, connu sous le nom de bois barré ou bois d’orignal) et les huiles végétales biologiques qui ne présentent aucun potentiel allergène peuvent être utilisés.
7.2.12.6 Filtration du sirop et autres méthodes de traitement
Le sirop d’érable biologique ne doit pas être raffiné de manière artificielle, ni blanchi, ni décoloré. Toute manipulation du sirop d’érable visant à masquer des défauts de saveur, principalement celle du bourgeon, est interdite. Une filtration simple avec un tissu ou un papier, avec un filtre presse ou de la terre diatomée calcinée, ou l’utilisation de poudre de silice ou de poussière d’argile avec un filtre presse est autorisée afin de retirer les solides en suspension. L’utilisation de systèmes d’injection d’air avec soufflerie dans le sirop d’érable est interdite.
7.2.13 Nettoyage du matériel destiné à la fabrication du sirop
7.2.13.1 Système de collecte, tubulure et réservoirs d’eau d’érable
Chaque saison de production doit être précédée ou suivie d’un nettoyage. Les produits d’assainissement autorisés sont :
| Saison | Équipement | Produits assainissants autorisés |
|---|---|---|
| Temps des sucres | Pour tout l’équipement sauf la tubulure |
|
| Hors saison | Pour tout l’équipement y compris la tubulure |
Le nettoyage doit être suivi d’un rinçage à l’eau potable, avec un filtrat ou avec de la sève avant la saison suivante. |
| Pour la tubulure seulement |
Le nettoyage doit être suivi d’un rinçage à l’eau potable, avec un filtrat ou avec de la sève avant la saison suivante. |
Les autres substances, incluant celles à base d’acide phosphorique, sont interdites.
7.2.13.2 Osmoseur et membranes
Le nettoyage de l’osmoseur et des membranes doit se faire d’abord à l’aide du filtrat, en respectant le temps et la température recommandée par le fabricant.
- Nettoyage en saison de production :
- Si, après un rinçage avec un filtrat tiède (dans un circuit ouvert ou fermé), une mesure de la perméabilité à l’eau pure (PEP) de la membrane révèle une efficacité contrôlée inférieure à 85 % de l’efficacité contrôlée en début de saison, l’usage d’un savon à base de soude caustique (NaOH) recommandé par le fabricant pour le nettoyage des membranes est autorisé pour le nettoyage;
- si la mesure de la PEP demeure inférieure à 75 % de l’efficacité contrôlée en début de saison à la suite de l’utilisation d’un savon à base de NaOH, l’acide citrique est autorisé pour le nettoyage;
- un nettoyage ou une séquence de nettoyage à l’aide des substances permises en 7.2.13.2 a 1 et 2, doit être suivi d’un rinçage à l’aide d’un filtrat ou d’eau potable propre. Le volume de rinçage doit être égal ou supérieur à 40 fois le volume mort résiduel de l’appareil (le volume contenu dans l’appareil et ses composantes une fois l’appareil drainé);
- les relevés et les calculs d’efficacité doivent être quotidiennement consignés dans un registre. L'élimination de l’eau de rinçage de la membrane doit être faite en tout respect de l’environnement.
- Nettoyage après la saison de production : le traitement des membranes à l’acide citrique est permis hors saison. Après un traitement à l’acide citrique, il est permis d’utiliser l’acide acétique, l’acide peracétique et le peroxyde d’hydrogène.
7.2.13.3 Évaporateurs
En tout temps, les évaporateurs peuvent être lavés à l’eau potable ou avec du filtrat, en ajoutant, si nécessaire, de l'acide acétique ou des produits à base d'acide acétique, de peroxyde d'hydrogène ou d’acide peracétique. La sève fermentée peut aussi être utilisée à la fin de la saison. En cas d’utilisation d’acide acétique ou de produits à base d'acide acétique, de peroxyde d'hydrogène ou d’acide peracétique, un double rinçage est obligatoire, et le deuxième rinçage doit se faire avec de l’eau, du filtrat ou de la sève chauds.
7.2.13.4 Produits interdits
Tout produit autre que ceux mentionnés en 7.2.13.1, 7.2.13.2 et 7.2.13.3 est interdit, y compris les produits à base d’acide phosphorique.
7.2.14 Additifs alimentaires et auxiliaires de production
La transformation du sirop d’érable en produits dérivés (comme le beurre d’érable, le sucre et la tire) doit être effectuée conformément à la présente norme. L’ébullition au micro-ondes est interdite. Aucun autre produit ne doit être ajouté au sirop ou aux autres produits de l’érable pendant leur production ou leur préparation, que ce soit pour en améliorer le goût, la texture ou l’aspect. Les cornets peuvent être utilisés s’ils représentent moins de 5 % du poids du produit final.
7.2.15 Transport, entreposage et conservation
Le sirop d’érable en vrac doit être entreposé dans des contenants constitués de matériaux de grade alimentaire qui n’altèrent pas la composition chimique ni la qualité du sirop. Les contenants autorisés sont les barils en acier inoxydable, en fibre de verre, en plastique de grade alimentaire ou en métal recouvert d’un enduit de grade alimentaire à l’intérieur. La réutilisation de barils à usage unique est interdite. Les barils doivent porter un numéro unique qui doit être consigné dans les registres du producteur. La date de remplissage du baril doit être consignée.
7.3 Production de champignons
Tous les paragraphes pertinents dans la présente norme, dont 5.1.3, 5.1.4, 5.1.6 et 5.1.7, s’appliquent à la production de champignons lorsque ce paragraphe n’inclut aucune exigence spécifique. Pour la production extérieure, 5.2.2 s’applique également.
7.3.1 Sites et structures de production
Pour les champignons et les produits de champignons biologiques, l’exploitant doit gérer ses unités de production de manière à ce que les substrats et les champignons ne soient pas en contact avec des substances interdites. Les substrats doivent avoir été produits en conformité avec la présente norme et avec les substances applicables du tableau 4.2 (colonne 1) de la norme CAN/CGSB-32.311, tels que Matières destinées au compostage, et Compost produit sur les lieux d’une exploitation :
- à l’intérieur des installations, les champignons biologiques ne peuvent entrer en contact avec des substances interdites qui pourraient compromettre l’intégrité biologique de la récolte;
- lorsque les champignons sont cultivés dans le sol, aucune substance interdite ne doit avoir été utilisée pendant au moins 36 mois avant la récolte du produit biologique;
- dans le cas des nouvelles installations ou lors de leur rénovation, le bois traité avec des substances interdites ne doit pas être utilisé pour les structures, contenants et autres surfaces qui entrent en contact avec le substrat de croissance ou les champignons.
7.3.2 Substrats et milieux de croissance
7.3.2.1 Substrats à base de bois
Les billots, la sciure de bois ou les autres matériaux dérivés du bois utilisés comme substrats doivent provenir de bois, d’arbres ou de billots qui n’ont pas été traités avec des substances interdites.
7.3.2.2 Déjections animales
Le paragraphe 5.5.1 s’applique aux déjections animales utilisées dans le substrat de croissance (incluant toutes substances agricoles non biologiques contenues dans ces déjections); les déjections animales doivent être compostées conformément aux exigences relatives aux amendements du sol décrites au tableau 4.2 (colonne 1) de la norme CAN/CGSB-32.311.
7.3.2.3 Autres substances agricoles
Si elles ne sont pas compostées, les substances agricoles telles que la paille, les grains ou le foin utilisées comme substrats de croissance doivent provenir de sources biologiques. Si ces substances biologiques ne sont pas disponibles sur le marché, l’exploitant peut utiliser des substances non biologiques si elles ont été compostées conformément aux exigences relatives aux amendements du sol décrites au tableau 4.2 (colonne 1) de la norme CAN/CGSB-32.311.
7.3.3 Blanc de champignon
Un blanc de champignon (semence) biologique doit être utilisé. Le blanc de champignon cultivé ou traité avec des substances répertoriées au tableau 4.2 (colonne 2) de la norme CAN/CGSB-32.311 peut être utilisé si le blanc de champignon biologique :
- ne peut être obtenu sur l’unité de production;
- n’est pas disponible sur le marché.
7.3.4 Lutte contre ravageurs et substances d’assainissement
Les mesures préventives de contrôle des maladies doivent inclure :
- l’évacuation des matières/matériaux infectés. Les souches de champignons infectées doivent être brûlées, ou transportées à au moins 50 m (164 pi.) du lieu de production (si, par exemple, les souches malades sont conservées pour la recherche), ou éliminées conformément aux bonnes pratiques recommandées;
- l’assainissement à l’aide de substances répertoriées au tableau 4.2 (colonne 2) de la norme CAN/CGSB-32.311;
- l’utilisation de sites de culture exempts de débris provenant d’arbres du sous-étage malades et infectés par d’autres ravageurs;
- le nettoyage et l’entretien de l’équipement avec des agents assainissants et désinfectants répertoriés au tableau 4.2 (colonne 2) de la norme CAN/CGSB-32.311.
7.3.5 Préparation des produits de champignons
Les articles 8.1 et 8.2 s’appliquent à la préparation des produits biologiques.
7.3.6 Gestion des organismes nuisibles en installation
L'article 8.3 s’applique aux pratiques de gestion des organismes nuisibles à l’intérieur et autour des installations de production de champignons.
7.4 Production de germinations, de pousses et de microverdurettes
L'article 7.4 s’applique aux cultures récoltées dans les 30 jours suivant l’imbibition, soit consommées avec leurs racines (p. ex., germinations et nanopousses), soit séparées de leurs racines pour la consommation (p. ex., pousses, verdurettes vivantes et micro verdurettes). L'article 7.4 ne s’applique pas aux produits entiers avec tête (p. ex. têtes de laitue, chou miniature).
Les germinations, pousses et microverdurettes peuvent être produites dans l’eau ou dans un substrat de croissance, peu importe que la culture ait lieu dans une chambre ou un récipient de croissance, une serre ou sous toute autre structure protectrice.
7.4.1 Seules les semences biologiques peuvent être utilisées.
Note : Un programme de surveillance de l'eau devrait être en place pour assurer que l'eau est potable.
7.4.2 L’éclairage artificiel est permis pour compléter ou remplacer la lumière naturelle.
7.4.3 Les contenants inertes en acier inoxydable et plastique de qualité alimentaire sont permis dans les systèmes de production dans l’eau et en substrats de croissance.
7.4.4 Les contenants constitués de matière végétale non traitée (jute, fibre de coco, etc.) sont interdits dans les systèmes de production dans l’eau, mais permis dans les systèmes de production en substrats de croissance.
7.4.5 Les engrais sont interdits à tous les stades de croissance et de récolte dans les systèmes de production dans l’eau.
7.4.6 Si la culture des germinations, pousses ou microverdurettes a lieu dans un substrat de croissance, les substances répertoriées au tableau 4.2 (colonne 1) de la norme CAN/CGSB-32.311 sont permises comme substrat de croissance et pour la nutrition des plantes. La structure physique du substrat de croissance doit comprendre une fraction minérale (sable, limon or argile, excluant la perlite et la vermiculite) et une fraction organique.
7.4.7 Les substances employées pour le nettoyage ou l’assainissement des semences doivent se limiter à celles prévues à cette fin aux tableaux 4.2 (colonne 2) ou 7.3 de la norme CAN/CGSB-32.311.
7.4.8 Tout exploitant qui cultive des germinations, pousses ou microverdurettes doit :
- utiliser, dans la mesure du possible, des contenants et des caissettes réutilisables et recyclables;
- réutiliser ou recycler le substrat de croissance, si possible;
- utiliser des substances répertoriées au tableau 4.2 (colonne 2) de la norme CAN/CGSB-32.311 en tant qu’auxiliaires de production végétale;
- utiliser pour l’équipement les nettoyants, désinfectants et produits assainissants appropriés qui figurent aux tableaux 7.3 et 7.4 de la norme CAN/CGSB-32.311.
7.4.9 Préparation des produits dérivés des germinations, pousses et microverdurettes
Les articles 8.1 et 8.2 s’appliquent à l’étape de préparation des produits biologiques récoltés
7.4.10 Gestion des organismes nuisibles en installation
L'article 8.3 s’applique aux pratiques de gestion des organismes nuisibles à l’intérieur et autour des installations.
7.5 Cultures produites sous des structures ou en contenants (auparavant appelées « cultures en serre »)
L'article 7.5 s’applique :
- à toutes les productions végétales biologiques cultivées en contenants (à l’intérieur ou à l’extérieur). Les contenants incluent les systèmes de production qui limitent le contact des racines avec le sol natif, tels que les cultures en pots, bacs et couches tapissées de plastique, etc.
- aux cultures cultivées en plein sol en utilisant de l’éclairage d’appoint, du chauffage ou un apport de CO2, à l’intérieur de structures, telles qu’une serre, des tunnels (hauts ou bas), des arceaux, etc.
Cet article ne s’applique pas :
- aux germinations, pousses et microverdurettes (l'article 7.4);
- aux cultures produites en plein sol sous des structures, tel qu’un châssis froid, ou un tunnel chenille, sans éclairage d’appoint, ni chauffage, ni apport de CO2; ou
- aux cultures sous mini-tunnels, filets anti-insectes ou filets anti-oiseaux (régies par la section 5).
Toutes les clauses pertinentes de la présente norme, dont 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6 et 5.1.7, s’appliquent à la production de cultures sous des structures ou en contenants lorsque ce paragraphe n’inclut aucune exigence spécifique.
7.5.1 Dans un système permanent de culture en plein sol, aucune substance interdite ne doit avoir été utilisée pendant une période d’au moins 36 mois avant la récolte d’une culture biologique.
7.5.2 La production en culture hydroponique et aéroponique est interdite.
7.5.2.1 Le sol utilisé dans un système de production en contenants doit :
- ne pas contenir de substances interdites (CAN/CGSB-32.310; voir : 1.5);
- être constitué de substances recensées au tableau 4.2 (colonne 1) de la norme CAN/CGSB-32.311;
- contenir une fraction minérale (sable, limon ou argile, excluant la perlite et la vermiculite) et une fraction organique, qui contribuent à la structure physique du sol;
- contenir au moins 10 % en volume de compost (exception : les terreaux pour les semis et plants à repiquer peuvent contenir moins de 10 % de compost si des quantités moindres sont nécessaires pour assurer une germination/enracinement adéquat), et
- contenir au moins 2 % en minéraux (sable, limon ou argile, excluant la perlite et la vermiculite) en poids sec ou en volume (suivant l’unité de mesure appropriée) au début du cycle de production.
7.5.2.2 Le volume de sol de départ et le volume de sol maintenu dans les contenants doivent être proportionnels à la taille, au taux de croissance, au rendement visé et à la longueur du cycle de culture.
- Pour les cultures produites sous des structures et couvertes par 7.5, la superficie photosynthétique comprend la surface totale du plancher allouée à la production végétale, incluant les allées et espaces entre les plantes, mais excluant les zones non productives telles que les passages principaux et allées centrales, les allées de service, les aires d’entreposage, etc.
- Pour les cultures en contenants cultivées à l’extérieur, la surface photosynthétique comprend la surface du sol consacrée à la production végétale, incluant les allées piétonnes et les espaces et allées entre les plantes, mais excluant les surfaces non productives, telles que les voies d'accès aux champs, les aires de retournement, les haies, les aires de stockage, etc.
- La longueur du cycle de production variera à travers le pays, particulièrement dans les structures non chauffées, et doit être prise en considération pour déterminer le volume de sol requis. Pour les cultures pérennes, la longueur du cycle de production sera calculée depuis le début de la croissance saisonnière jusqu’à la fin de la récolte en fin de saison.
Remarque
Le sol des transplants et autres cultures en contenants difficiles à cultiver en surface (par exemple, les fraisiers) doit être suffisamment riche avant le début de la culture pour assurer une nutrition continue pendant toute la durée de cette culture. Si cela n’est pas possible, des amendements liquides répertoriés au tableau 4.2 (colonne 1) de la norme CAN/CGSB-32.311 peuvent être utilisés.
7.5.2.3 La quantité minimale de sol requise pour les cultures non couvertes par 7.5.2.4 est de 2,5 L (0,66 gal) de sol par m2 de surface photosynthétique par semaine de production végétale. La quantité maximale de terre nécessaire dans tous les cas est de 60L/m2 de surface photosynthétique. Le temps de production des cultures est compté à partir du début de la propagation de la plante (par exemple semis, collage des boutures végétatives non racinées, divisions, etc.) jusqu'à la récolte finale.
7.5.2.4 Les productions en contenants de cultures maraîchères tuteurées semi-indéterminées et indéterminées (par exemple, tomates, poivrons, concombres, aubergines) sont soumises aux conditions suivantes :
- des applications additionnelles de compost doivent faire partie du programme de fertilisation;
- le volume minimal de sol maintenu doit être de 60 L/m2 (1,2 gal/pi2), calcul basé sur la superficie photosynthétique. L’insertion de cultures intercalaires à cycle court entre d’autres cultures (par exemple, le basilic entre les rangs de tomates) ou la production de plusieurs cultures à cycles courts pendant l’année (par exemple, les concombres) ne réduisent pas cette exigence de 60 L/m2;
- les unités de production qui existaient avant novembre 2016, qui ont fait l’objet d’une gestion biologique continue par le même exploitant, qui n’ont pas subi de rénovations majeures, qui n’ont pas changé d’aire de production et qui ne sont pas conformes à 7.5.2.4 b peuvent continuer à produire des cultures tuteurées avec un volume de sol inférieur à 60 L/m2 (1,2 gal/pi2).
Remarque
La Partie 13 Produits biologiques du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada exige que la demande de certification biologique de végétaux cultivés en serre dans un système permanent de culture en plein sol soit présentée dans un délai d’au moins 15 mois avant la date prévue de mise en marché. Durant cette période, l’organisme de certification évalue la conformité aux exigences de la présente norme. L’évaluation doit comprendre au moins une inspection de l’unité de production, au cours de la production, dans l’année précédant le moment où les végétaux peuvent devenir admissibles à la certification et une inspection, durant la production, dans l’année où les végétaux sont admissibles à la certification. Cette exigence ne s’applique pas aux serres construites sur une terre qui fait partie d’une exploitation biologique existante. S’il s’agit d’une première demande de certification biologique de végétaux cultivés en contenants, la demande de certification biologique doit être présentée dans un délai d’au moins 12 mois avant la date prévue de mise en marché.
7.5.3 Le chauffage avec des sources de chaleur supplémentaires et l’enrichissement en dioxyde de carbone (CO2) sont permis. Une fertilisation d’appoint avec des substances répertoriées au tableau 4.2 (colonne 1) de la norme CAN/CGSB-32.311 peut être appliquée
7.5.4 La lumière du soleil doit être la principale source de lumière pour la photosynthèse pour toutes les cultures visées par l'article 7.5. Un éclairage d’appoint peut être utilisé. Par exception, les semis annuels d’hiver ou de printemps dont les plants seront transplantés dans l’exploitation peuvent être démarrés par l'exploitation sous un éclairage artificiel à 100 % jusqu’à l’étape de la première transplantation, c'est-à-dire lorsque les plants issus du semis sont repiqués dans un autre milieu de culture (en cassette, en pot, en contenant ou en plein sol).
7.5.5 Pour les cultures récoltées dans les 30 jours suivant l’imbibition des semences, seules les semences biologiques doivent être utilisées.
7.5.6 Les plantes et le sol, y compris le terreau d’empotage, ne doivent pas entrer en contact avec des substances interdites ni avec le bois traité avec de telles substances
7.5.7 Pour la production de cultures, l’exploitant doit :
- utiliser, dans la mesure du possible, des pots et des caissettes réutilisables ou recyclables;
- utiliser des substances énumérées au tableau 4.2 (colonne 1 ou 2) de la norme CAN/CGSB-32.311, s'il y a lieu;
- utiliser pour l’équipement les nettoyants, désinfectants et produits assainissants appropriés mentionnés aux tableaux 7.3 et 7.4 de la norme CAN/CGSB-32.311.
7.5.8 Il est permis de recourir aux méthodes, aux procédés ou aux substances suivants pour :
- nettoyer et désinfecter les structures de protection, l’équipement qui entre en contact avec le sol ou les cultures, et les contenants, pots et caissettes :
- les substances énumérées aux tableaux 7.3 ou 7.4 de la norme CAN/CGSB-32.311;
- le traitement à la vapeur.
- stimuler la croissance ou le développement :
- les substances énumérées au tableau 4.2 (colonne 1 ou 2) de la norme CAN/CGSB-32.311;
- le contrôle de la température quotidienne et des niveaux d’éclairage;
- prévenir et combattre les ravageurs, incluant les maladies, les insectes ou autres organismes :
- les substances mentionnées au tableau 4.2 (colonne 2) de la norme CAN/CGSB-32.311;
- la taille;
- l’épuration;
- l’aspiration;
- la manipulation de la température, par exemple le refroidissement, le chauffage, le traitement à la vapeur;
- les filtres à air, les moustiquaires ou autres moyens physiques pour empêcher les organismes nuisibles d’entrer dans la serre;
- les méthodes de lutte biologique.
7.5.9 Des pratiques de régénération et de recyclage du sol doivent être employées. Des techniques autres que la rotation des cultures sont admises : le greffage des plantes sur des porte-greffes résistants aux maladies, le gel hivernal du sol, la régénération du sol par l’introduction de paillis végétaux biodégradables (paille ou foin) et le remplacement partiel ou complet du sol de la serre ou des contenants. Le sol usé doit être réutilisé soit dans la serre, soit sur une autre culture, à moins qu'une directive réglementaire visant à éviter la propagation d'un ravageur (incluant insectes ou maladies) ne rende obligatoire l'élimination du sol usé.
7.5.10 Préparation des produits végétaux en serre
Les articles 8.1 et 8.2 s’appliquent à l’étape de préparation des produits biologiques.
7.5.11 Gestion des organismes nuisibles en installation
L'article 8.3 s’applique aux pratiques de gestion des organismes nuisibles à l’intérieur et autour des installations.
7.6 Cueillette de plantes sauvages
7.6.1 Toute plante sauvage biologique doit être récoltée dans une zone ou unité de production clairement délimitée. L’exploitant doit fournir une documentation qui confirme qu’aucune substance interdite n’a été appliquée pendant au moins 36 mois avant la récolte de plantes sauvages.
7.6.2 L’exploitant doit préparer un plan de production biologique (voir 4.1, 4.2 et 4.3) qui inclut :
- une description détaillée des zones de production et des méthodes de récolte;
- les pratiques de gestion qui préservent les espèces sauvages et préviennent la perturbation du milieu;
- un système de tenue de registres qui répondent aux exigences énoncées en 4.4.
7.6.3 Les produits sauvages sont considérés comme étant biologiques seulement s’ils sont récoltés dans des milieux naturels stables ou relativement non perturbés. Une plante sauvage doit être récoltée ou cueillie de manière à favoriser la croissance et la production et sans endommager le milieu.
7.6.4 La zone de production de plantes sauvages doit être protégée de tout contact avec des substances interdites par une zone tampon clairement délimitée (voir 5.2.2). Les sites de cueillette doivent se trouver à une distance de plus d’un kilomètre (0.62 mi) de sources potentielles de contamination, tels les terrains de golf, les dépotoirs, les sites d’enfouissement sanitaire ou les complexes industriels.
7.6.5 Préparation des produits dérivés de la cueillette sauvage
Les articles 8.1 et 8.2 s’appliquent à l’étape de préparation des produits biologiques.
7.6.6 Gestion des organismes nuisibles en installation
L'article 8.3 s’applique aux pratiques de gestion des organismes nuisibles à l’intérieur et autour des installations.
7.7 Insectes biologiques
Tous les éléments pertinents des articles 1 à 6 de la présente norme s’appliquent.
8 Maintien de l’intégrité biologique durant le nettoyage, la préparation et le transport
La section 8 s’applique à toutes les opérations de production et de transformation relatives à la manipulation (y compris l’emballage et l’étiquetage), à l’entreposage et au transport des produits biologiques. Durant l’exécution de ces activités, l’objectif central est de maintenir les qualités biologiques intrinsèques du produit final grâce à une stricte adhésion aux procédures et aux principes de la présente norme. Les exploitants sont responsables du maintien de l’intégrité biologique en tout point de la chaîne d’approvisionnement, depuis la production jusqu’au point de vente au consommateur.
8.1 Maintien de l’intégrité
8.1.1 Tout matériau de préparation, comme les comptoirs, les contenants et les convoyeurs entrant en contact avec les aliments, doit être propre et de qualité alimentaire.
8.1.2 Les additifs indirects ne doivent pas compromettre l’intégrité biologique :
- les désinfectants à main, s’ils sont utilisés en contact direct avec les produits biologiques, doivent figurer au tableau 7.3 de la norme CAN/CGSB-32.311;
- la vapeur culinaire, soit la vapeur en contact direct avec les produits biologiques ou l’emballage, ne doit contenir que :
- les substances énumérées aux tableaux 6.3, 6.4 ou 6.5 de la norme CAN/CGSB-32.311;
- les nettoyants, désinfectants et agents d’assainissement de grade alimentaire autorisés pour le contact avec les produits biologiques au tableau 7.3 de la norme CAN/CGSB-32.311.
- les lubrifiants en contact avec les aliments doivent être énumérés aux tableaux 6.3, 6.4 à 6.5 de la norme CAN/CGSB-32.311;
- l’utilisation de nettoyants, désinfectants et agents d’assainissement doit être conforme aux exigences de l'article 8.2 de la présente norme.
8.1.3 Les procédés mécaniques, physiques ou biologiques (tels que la fermentation et le fumage) sont permis.
8.1.4 Les produits biologiques doivent être en tout temps séparés ou autrement protégés des produits non biologiques afin de prévenir tout mélange, que ce soit durant la transformation, l’entreposage, ou la manutention des denrées en vrac et non liées.
8.1.5 Lorsque des produits biologiques et non biologiques sont préparés dans une même unité de production :
- les produits biologiques et les produits non biologiques ne doivent pas être mélangés à quelque étape que ce soit de la production;
- toutes les mesures doivent être prises pour assurer l’identification des produits et distinguer les produits biologiques et non biologiques finaux;
- les exploitants doivent documenter les méthodes de nettoyage employées pour prévenir la contamination croisée entre les cycles de production des produits biologiques et non biologiques;
- la préparation des produits biologiques doit être faite en continu jusqu’à ce que le cycle de production soit complété;
- les cycles de production biologique doivent être séparés dans l’espace ou dans le temps des opérations similaires réalisées lors de la préparation des produits non biologiques;
- les cycles de production des produits biologiques doivent être planifiés afin de prévenir le mélange;
- des mesures supplémentaires sont requises pour les cultures à risque afin de prévenir les mélanges accidentels de grains ou de semences biologiques en vrac avec des grains non biologiques qui pourraient contenir des traces de contamination par des cultures issues du génie génétique :
- les bacs de stockage utilisés pour les cultures biologiques doivent être visiblement identifiés comme étant biologiques à l’aide de panneaux d’affichage bien entretenus et résistants aux intempéries;
- quand les cultures biologiques à risque sont transférées d’un bac de stockage en vrac à l’autre (par exemple, lors du séchage des grains ou mélange des lots), un affichage temporaire doit être apposé sur le wagon ou le camion pour identifier visiblement la charge biologique en transit;
- lorsque les cultures biologiques sont conservées dans des bacs en vrac pour le séchage ou le rôtissage, un affichage temporaire doit être ajouté au bac pour indiquer de façon visible que son contenu est biologique.
8.1.6 L’emballage des produits biologiques doit :
- maintenir la qualité et l’intégrité des produits biologiques;
- être réduit au minimum, conformément à 8.1.6 a. Il faut privilégier les matériaux d’emballage dont les impacts négatifs sur l’environnement sont les moindres tout au long de leur cycle de vie;
- respecter les interdictions mentionnées en 1.4 b et 1.4e.
8.2 Nettoyage, désinfection et assainissement
8.2.1 Les produits de nettoyage, de désinfection et d’assainissement de qualité alimentaire répertoriés au tableau 7.3 de la norme CAN/CGSB-32.311 peuvent être utilisés conformément aux indications :
- sur les surfaces en contact avec les produits biologiques, incluant l’équipement, les unités de rangement et de stockage et les unités de transport;
- en contact direct avec les produits biologiques.
8.2.2 Les nettoyants, désinfectants et agents d’assainissement inscrits au tableau 7.4 de la norme CAN/CGSB-32.311 peuvent être utilisés sur les surfaces en contact avec les produits biologiques, à condition que la documentation montre que :
- l’utilisation est conforme à l’annotation pour cette substance; et
- les substances sont complètement éliminées des surfaces en contact avec les produits biologiques avant chaque cycle de production.
8.2.3 Si les substances des tableaux 7.3 et 7.4 ne sont pas efficaces, d’autres nettoyants, désinfectants ou agents d’assainissement peuvent être utilisés sur les surfaces en contact avec les produits biologiques, s’il est documenté que les conditions suivantes sont respectées :
- les substances de remplacement sont efficaces;
- il y a une élimination complète de la ou des substances de remplacement avant chaque cycle de production biologique;
- les effluents rejetés sont neutralisés afin de réduire au minimum leurs impacts négatifs sur l’environnement.
8.2.4 Les exigences de nettoyage, de désinfection ou d’assainissement spécifiques énoncées à la section 7 de la présente norme ont préséance sur celles stipulées en 8.2.
8.3 Gestion de la lutte contre les organismes nuisibles dans l’installation et après la récolte
8.3.1 De bonnes pratiques de production et de fabrication doivent être mises en place afin de prévenir la présence d’organismes nuisibles. Les pratiques de lutte contre les organismes nuisibles doivent comprendre, en ordre décroissant :
- l’élimination de l’habitat et de la nourriture des organismes nuisibles;
- la prévention de l’accès et la gestion environnementale (par exemple, lumière, température et atmosphère) pour prévenir l’intrusion et la reproduction des organismes nuisibles;
- les méthodes physiques et mécaniques telles que les pièges;
- les appâts et les répulsifs inscrits au tableau 8.2 de la norme CAN/CGSB-32.311.
8.3.2 Si les pratiques énumérées en 8.3.1 sont inefficaces, l’exploitant peut utiliser des substances de lutte contre les organismes nuisibles inscrites au tableau 8.2 de la norme CAN/CGSB-32.311. L’exploitant doit consigner l’information concernant les organismes nuisibles visés, les substances utilisées, les dates de début et de fin de leur utilisation et l’emplacement des dispositifs de lutte antiparasitaire.
8.3.3 Si les pratiques mentionnées en 8.3.2 sont inefficaces, des substances non inscrites au tableau 8.2 de la norme CAN/CGSB-32.311 peuvent être utilisées à tous les endroits où sont préparés les produits biologiques, incluant les entrepôts hors site, pourvu qu’il n’y ait aucun risque pour le statut ou l’intégrité du produit biologique. L’exploitant doit s’assurer que ni les produits biologiques ni leur matériau d’emballage ne sont présents quand de telles substances sont utilisées à l’intérieur des installations. Les exploitants doivent clairement documenter :
- pourquoi les substances permises ne convenaient pas ou étaient inefficaces pour la lutte contre les organismes nuisibles;
- comment le contact des produits biologiques avec ces substances non inscrites a été prévenu;
- toutes les activités liées à l’utilisation, l’entreposage et l’élimination des substances non listées.
8.3.4 Les exploitants doivent surveiller et documenter l’utilisation des substances non inscrites au tableau 8.2 de la norme CAN/CGSB-32.311 utilisées dans le cadre de tout programme gouvernemental obligatoire pour le traitement des organismes nuisibles et des maladies.
Remarque
Au Canada, advenant une épidémie de ravageurs, l’exploitant est tenu d’aviser sans délai l’organisme de certification de tout changement qui pourrait affecter le processus de certification du produit biologique.
8.3.5 Les substances inscrites au tableau 8.3 de la norme CAN/CGSB-32.311 peuvent être utilisées pour l’entreposage après récolte.
8.4 Transport
8.4.1 Toutes les mesures doivent être prises pour éviter de compromettre l’intégrité des produits, ingrédients ou intrants biologiques pendant le transport. Les produits doivent être séparés physiquement ou protégés afin d’éviter tout mélange ou substitution du contenu avec des produits, ingrédients ou intrants non biologiques.
8.4.2 Les renseignements suivants doivent accompagner le produit biologique :
- le nom et l’adresse de la personne ou de l’organisme responsable de la production, de la préparation ou de la distribution du produit;
- le nom du produit;
- le statut biologique du produit; et
- les renseignements qui permettent d’assurer la traçabilité du produit, comme le numéro de lot.
8.4.3 Les produits biologiques ne doivent pas être exposés aux pesticides ou substances de lutte contre les organismes nuisibles non inscrits au tableau 8.2 de la norme CAN/CGSB-32.311 durant le transport ou tout passage frontalier.
Remarque
Les propriétaires de produits biologiques sont responsables de l’intégrité biologique de leurs produits tout au long du processus de transport. Ceci comprend l’utilisation des services de messagerie courants et des services de transport sur mesure. Les entreprises de transport partagent les responsabilités ayant trait à l’intégrité du produit quand elles chargent, transportent ou déchargent des produits biologiques certifiés.
9 Composition des produits biologiques
La section 9 s’applique à toutes les exploitations impliquées dans la préparation de produits biologiques, de même qu’aux détaillants qui préparent les produits
9.1 Composition du produit
9.1.1 Les produits biologiques doivent être principalement composés d’ingrédients agricoles biologiques entiers ou transformés, d'ingrédients aquacoles, biologiques entiers ou transformés (voir 2.1, CAN/CGSB-32.312), et d’auxiliaires de production biologiques. La présence d’autres ingrédients et auxiliaires de production permis, décrits en 9.2, doit être réduite au minimum.
9.1.2 L’évaluation de la composition du produit doit exclure les sous-parties non agricoles des ingrédients répertoriés aux tableaux 6.3 et 6.4 de la norme CAN/CGSB-32.311 qui ont un effet technique ou fonctionnel sur un ingrédient, mais pas sur le produit fini biologique, et ne sont pas déclarées sur l’étiquette du produit fini biologique. Ces sous-parties d’ingrédient peuvent être présentes dans le produit fini biologique, mais seulement en quantités négligeables. Il s’agit de sous-parties non agricoles, par exemple d’agents anti-agglomérants, d’excipients ou d’agents de remplissage, d’agents de conservation, de stabilisants, de régulateurs de pH ou de tampons. Le calcul du pourcentage du contenu biologique doit tenir compte de tous les ingrédients constitutifs et des sous-parties de ces ingrédients, en distinguant les composants biologiques et non biologiques de chaque ingrédient contenu dans le produit.
9.1.3 Le pourcentage de tous les ingrédients biologiques dans un produit biologique doit être calculé de la manière suivante :
- Produits solides (à l’exclusion des aliments pour animaux d’élevage : voir 9.1.3 d : diviser la masse nette, en excluant l’eau et le sel, de tous les ingrédients biologiques présents dans la formulation ou le produit fini, suivant ce qui est le plus pertinent, par la masse nette de tous les ingrédients, en excluant l’eau et le sel;
- Produits liquides: si le produit et ses ingrédients sont liquides, diviser le volume fluide de tous les ingrédients biologiques en excluant l’eau et le sel par le volume fluide de tous les ingrédients (à l’exclusion de l’eau et du sel). Si le panneau principal de l’emballage, la fiche de spécifications ou le certificat d’analyse incluent des énoncés tels que « reconstitué à partir de concentrés » pour décrire le produit final, le volume non concentré des ingrédients ou du produit fini doit être utilisé pour calculer le pourcentage du contenu biologique du produit. Tout utilisateur d’un ingrédient auquel de l’eau ou du sel a été ajouté par un transformateur antérieur doit exclure cette eau ou ce sel ajoutés lors du calcul du pourcentage d’ingrédients biologiques lorsque l’eau ou le sel est déclaré sur la liste des ingrédients du produit fini;
- Produits solides et produits liquides : diviser la masse nette des ingrédients biologiques solides, combinée à la masse nette des ingrédients biologiques liquides (à l’exclusion de l’eau et du sel) par la masse totale de tous les ingrédients contenus dans le produit fini, à l’exclusion de l’eau et du sel. Tout utilisateur d’un ingrédient auquel de l’eau ou du sel a été ajouté par un transformateur antérieur doit exclure cette eau ou ce sel lors du calcul du pourcentage d’ingrédients biologiques lorsque l’eau ou le sel est déclaré sur la liste des ingrédients du produit fini;
- Les aliments des animaux d’élevage doivent être faits à 100 % d’ingrédients agricoles biologiques et de suppléments ou additifs nécessaires inscrits au tableau 5.2 de la norme CAN/CGSB-32.311. Diviser la masse nette totale des ingrédients biologiques, en excluant l’eau, le sel et les composés du calcium, présents dans la formulation ou le produit fini, selon ce qui est le plus pertinent, par la masse totale de tous les ingrédients en excluant l’eau, le sel et les composés du calcium.
9.1.4 Le pourcentage de tous les ingrédients biologiques dans un produit biologique doit être arrondi au nombre entier inférieur le plus proche.
9.2 Classification des produits biologiques
Dépendamment du pourcentage des ingrédients biologiques qu’ils contiennent, les produits biologiques peuvent être regroupés en deux catégories :
9.2.1 Produits contenant 95 % ou plus d’ingrédients biologiques
Ces produits ne doivent pas contenir un ingrédient qui se trouve à la fois sous sa forme biologique et non biologique.
Ces produits peuvent contenir jusqu’à 5 % des ingrédients suivants :
- « ingrédients classés comme additifs alimentaires » et « ingrédients non classés comme additifs alimentaires » répertoriés respectivement aux tableaux 6.3 et 6.4 de la norme CAN/CGSB-32.311, et respectant les exigences spécifiées dans les annotations de même que les restrictions prévues en 6.2 de CAN/CGSB-32.311. Les ingrédients d’origine agricole énumérés doivent satisfaire aux exigences de 1.4 a, 1.4 c, et 1.4 d et à celles de 6.2 de la norme CAN/CGSB-32.311;
- auxiliaires de production non biologiques d’origine agricole qui satisfont aux exigences de 1.4 a, 1.4 b, 1.4 c, et 1.4 d, assujettis aux annotations énumérées au tableau 6.5 de la norme CAN/CGSB-32.311;
- auxiliaires de production d’origine non agricole répertoriés au tableau 6.5 de la norme CAN/CGSB-32.311, assujettis aux exigences prescrites dans les annotations liées à ces substances;
- ingrédients non biologiques d’origine agricole qui satisfont aux exigences de 1.4 a, 1.4 c et 1.4 d. Ces ingrédients sont également soumis aux critères de disponibilité sur le marché des produits biologiques.
9.2.2 Produits contenant de 70 à 95 % d’ingrédients biologiques
Ces produits ne doivent pas contenir un ingrédient qui se trouve à la fois sous sa forme biologique et non biologique.
Ces produits peuvent contenir jusqu’à 30 % des ingrédients suivants :
- les ingrédients non biologiques d’origine agricole qui respectent les exigences de 1.4 a, 1.4 c et 1.4 d;
- « ingrédients classés comme additifs alimentaires » et « ingrédients non classés comme additifs alimentaires » répertoriés respectivement aux tableaux 6.3 et 6.4 de la norme CAN/CGSB-32.311, et respectant les exigences spécifiées dans les annotations de même que les restrictions prévues en 6.2 prévue de la norme CAN/CGSB-32.311. Les ingrédients d’origine agricole doivent satisfaire aux exigences de 1.4 a, 1.4 c, 1.4 d et à celles de 6.2 de la norme CAN/CGSB-32.311;
- auxiliaires de production non biologiques d’origine agricole qui respectent les exigences de 1.4 a, 1.4 b, 1.4 c, et 1.4 d, ainsi que les annotations indiquées au tableau 6.5 de la norme CAN/CGSB-32.311;
- les auxiliaires de production d’origine non agricole répertoriés au tableau 6.5 de la norme CAN/CGSB-32.311, assujettis aux exigences prescrites dans les annotations liées à ces substances.
Remarque
Consulter l’annexe A pour un résumé de l’article 9.
10 Procédures, critères et conditions de modification de la norme CAN/CGSB-32.311 Systèmes de production biologique : Listes des substances permises
L’article 10 s’applique à toutes les modifications proposées aux listes des substances permises (LSP). Seules les substances génériques sont incluses dans la LSP. Les substances rattachées à un nom de marque, qui peuvent être une combinaison de substances génériques, ne peuvent être incluses dans les LSP. Le présent article ne s’applique pas aux matériaux d’emballage, aux surfaces d’équipement ni aux substances ou matériaux similaires.
10.1 Procédures d’examen des substances
10.1.1 Les critères énoncés dans le présent article régissent les modifications apportées à la norme CAN/CGSB-32.311.
10.1.2 Le processus d’examen des substances doit être ouvert, transparent et totalement participatif, en conformité avec les procédures de l’Office des normes générales du Canada (ONGC).
10.1.3 Il faut tenir compte des conséquences possibles qu’un modificatif proposé aurait sur l’équivalence et l’harmonisation de la présente norme avec les normes et règlements d’autres juridictions.
10.2 Critères visant les substances permises
10.2.1 Les substances incluses dans les LSP doivent être conformes :
- aux principes généraux de la production biologique prescrits dans la partie 0.2 de l’Introduction de la présente norme;
- aux articles 1.4 et 1.5.
10.2.2 L’examen des substances doit :
- tenir compte de la nécessité, de l’origine et du mode de production de la substance, ainsi que des impacts sociaux et écologiques de sa production et de son utilisation;
- inclure une description détaillée de la substance et une justification substantielle, ainsi que de la documentation en appui à la modification proposée;
- comprendre une évaluation de toutes les solutions de rechange disponibles, y compris les substances et les pratiques permises dans la présente norme et dans d’autres systèmes de production.
10.2.3 Le cas échéant, l’annotation qui accompagne une substance doit inclure :
- toute restriction quant à son origine et à son mode de production;
- toute restriction quant à sa composition et à son utilisation;
- une clause relative à sa disponibilité sur le marché qui autorise l’utilisation d’une substance de remplacement lorsque la forme privilégiée de la substance, comme l’indiquent les tableaux ci-dessous, n’existe pas en qualité ou en quantité suffisante au moment de la publication.
10.3 Critères d’examen de substances particulières
Les critères utilisés pour l’examen d’une substance sont décrits aux tableaux 10, 11, 12 et 13.
| Production végétale | Amendements du sol et nutrition des cultures (tableau 4.2, colonne 1, de la norme CAN/CGSB-32.311) | Auxiliaires et matières utilisés pour la production végétale (tableau 4.2, colonne 2, de la norme CAN/CGSB-32.311) |
|---|---|---|
| A. Nécessité | Doivent être nécessaires pour améliorer ou maintenir la fertilité du sol, satisfaire à des exigences particulières relatives aux cultures, et/ou pour soutenir la rotation des cultures, ou amender spécifiquement le sol quand les exigences ou les pratiques de la présente norme ne donnent pas satisfaction. | Doivent être nécessaires pour lutter contre les maladies, les insectes, les mauvaises herbes et les autres organismes nuisibles. Utilisés lorsqu’il n’existe aucune autre solution adéquate par la lutte biologique ou physique, par la sélection de variétés, ou par des pratiques de gestion efficaces. |
| B. Origine et mode de production |
|
|
| C. Impact | L’examen d’une substance doit tenir compte de :
|
|
| Production d’animaux d’élevage | Aliments des animaux d’élevage (tableau 5.2 de la norme CAN/CGSB-32.311) | Soins de santé des animaux d’élevage (tableau 5.3 de la norme CAN/CGSB-32.311) |
|---|---|---|
| A. Nécessité |
|
Doivent être nécessaires pour prévenir ou traiter les problèmes de santé des animaux d’élevage lorsqu’aucun autre traitement autorisé par la présente norme n’est disponible. |
| B. Origine et mode de production | Doivent être biologiques ou dérivées d’une matière minérale ou organique. | Doivent être d’origine biologique ou dérivées d’une matière minérale ou organique. |
| C. Impact | L’examen d’une substance doit tenir compte de :
|
|
| Transformation | Ingrédients alimentaires et auxiliaires de production (tableaux 6.3, 6.4 et 6.5 de la norme CAN/CGSB-32.311) |
|---|---|
| A. Nécessité |
|
| B. Origine et mode de production |
|
| C. Impact | Lors de l’examen, il faut tenir compte des impacts de l’utilisation et de la mauvaise utilisation potentielle d’une substance sur :
|
| Nettoyage et assainissement | Agents de Nettoyage et d'assainissement (tableaux 7.3 et 7.4 de la norme CAN/CGSB-32.311) | Substances pour la gestion des installations (tableaux 8.2 et 8.3 de la norme CAN/CGSB-32.311) |
|---|---|---|
| A. Nécessité | Les substances utilisées pour nettoyer et assainir les produits biologiques ou les surfaces qui entrent en contact avec les produits doivent être nécessaires et appropriées pour l’utilisation prévue. | Les substances utilisées pour lutter contre les organismes nuisibles ou pour produire un effet physiologique après la récolte doivent être nécessaires et appropriées pour l’utilisation prévue. |
| B. Origine et mode de production |
|
|
| C. Impact | L’examen d’une substance doit tenir compte de :
|
|
Annexe A (informative) Classification des produits biologiques
| Résumé | Catégories | ||
|---|---|---|---|
| 95 %tableau A note a (ou plus) |
70<95 %tableau A note b (ou plus) |
<70 %tableau A note c | |
| Ne peuvent contenir un ingrédient qui se trouve à la fois sous sa forme biologique et non biologique. | Applicable | Applicable | Sans objet |
| Peuvent contenir jusqu’à 5 % d’ingrédients non biologiques si ces ingrédients ne sont pas disponibles sur le marché sous forme biologique. | Applicable | Sans objet | Sans objet |
| Peuvent contenir jusqu’à 30 % d’ingrédients non biologiques. | Sans objet | Applicable | Sans objet |
| Peuvent contenir moins de 70 % d’ingrédients biologiques. | Sans objet | Sans objet | Applicable |
| Les ingrédients non biologiques « classés comme additifs alimentaires » et « non classés comme additifs alimentaires » doivent être répertoriés aux tableaux 6.3 et 6.4 de la norme CAN/CGSB-32.311), être conformes aux annotations spécifiées et à 6.2 de la norme CAN/CGSB-32.311). | Applicable | Applicable | Sans objet |
| Qu’ils soient répertoriés ou non aux tableaux 6.3 et 6.4 de la norme CAN/CGSB-32.311, les ingrédients non biologiques d’origine agricole doivent être conformes à 1.4 a, c et d et à 6.2 de la norme CAN/CGSB-32.311. | Applicable | Applicable | Sans objet |
| Les ingrédients non biologiques d’origine agricole qui ne sont pas répertoriés sont soumis aux exigences de disponibilité sur le marché. | Applicable | Sans objet | Sans objet |
| Les auxiliaires de production non biologiques d’origine agricole sont permis, et soumis aux exigences de 1.4 a, b, c, et d et aux annotations du tableau 6.5 de CAN/CGSB-32.311. | Applicable | Applicable | Sans objet |
| Les auxiliaires de production d’origine non agricole sont permis s’ils sont répertoriés au tableau 6.5 (auxiliaires de production) de la norme CAN/CGSB-32.311. | Applicable | Applicable | Sans objet |
Notes du tableau A.1
|
|||
Annexe B (informative) Principes de la production biologique dans l'histoire
Schéma illustrant les 12 étapes à suivre pour déterminer si une substance génétiquement modifiée est permise ou interdite
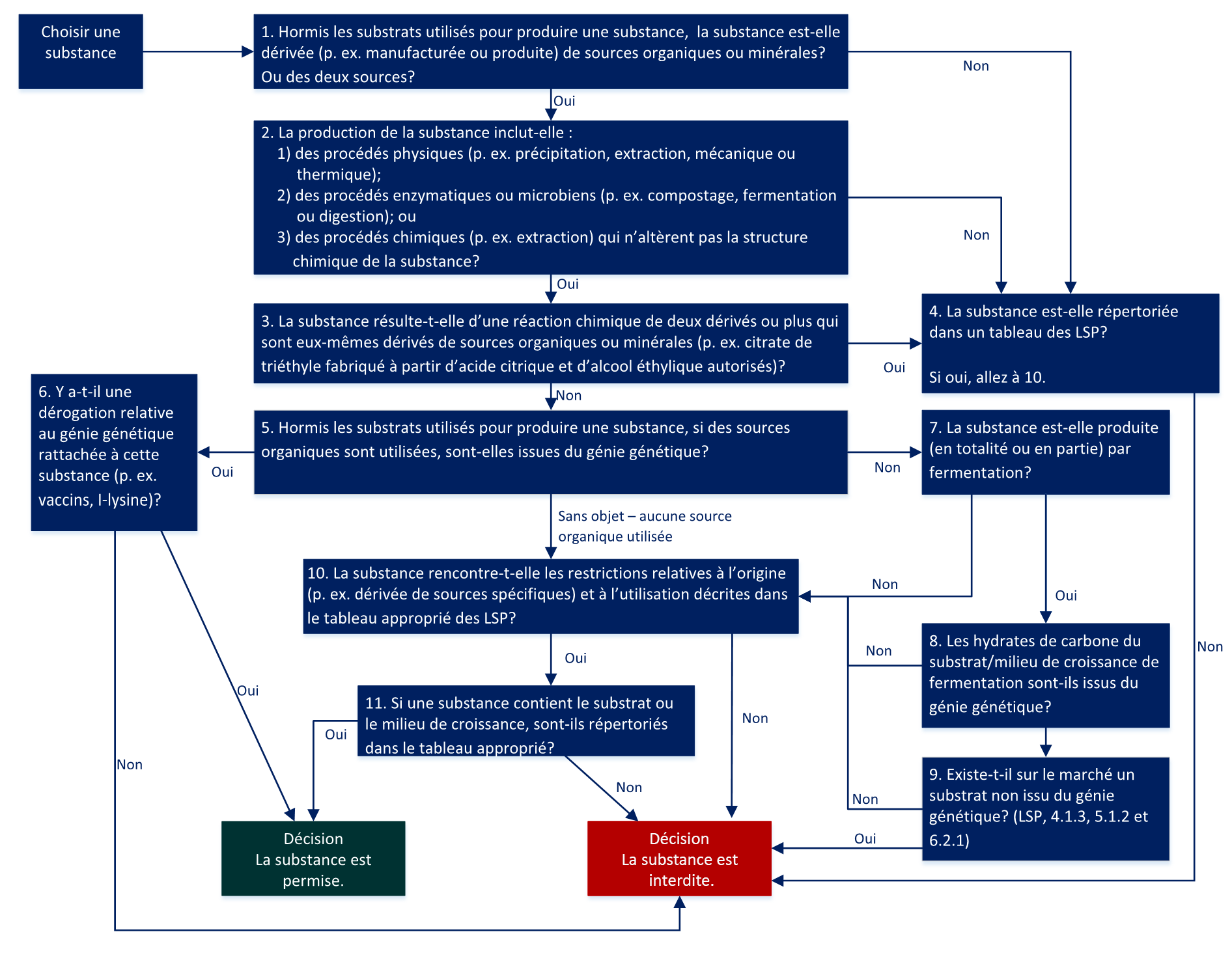
Description de l’image
Arbre de décision pour l’évaluation des substances permises
Il s'agit d'un diagramme de 11 questions possibles pour déterminer si une substance est autorisée ou non en tant qu'ingrédient biologique.
Choisir une substance
- Étape 1. Hormis les substrats utilisés pour produire une substance, la substance est-elle dérivée (par exemple, manufacturée ou produite) de sources organiques ou minérales? Ou des deux sources?
- Si Oui allez à l'étape 2.
- Si Non allez à l'étape 4.
- Étape 2. La production de la substance inclut-elle :
- 1) des procédés physiques (par exemple, précipitation, extraction, mécanique ou thermique);
- 2) des procédés enzymatiques ou microbiens (par exemple, compostage, fermentation ou digestion); ou
- 3) des procédés chimiques (par exemple, extraction) qui n’altèrent pas la structure chimique de la substance?
- Si Oui allez à l'étape 3.
- Si Non allez à l'étape 4.
- Étape 3. La substance résulte-t-elle d’une réaction chimique de deux dérivés ou plus qui sont eux-mêmes dérivés de sources organiques ou minérales (par exemple, citrate de triéthyle fabriqué à partir d’acide citrique et d’alcool éthylique autorisés)?
- Si Oui allez à l'étape 4.
- Si Non allez à l'étape 5.
- Étape 4. La substance est-elle répertoriée dans un tableau des LSP?
- Si Oui allez à l'étape 10.
- Non : Décision – La substance est interdite.
- Étape 5. Hormis les substrats utilisés pour produire une substance, si des sources organiques sont utilisées, sont-elles issues du génie génétique?
- Si Oui allez à l'étape 6.
- Si Non allez à l'étape 7.
- Sans objet – aucune source organique utilisée (étape 10)
- Étape 6. Y a-t-il une dérogation relative au génie génétique rattachée à cette substance (par exemple, vaccins, I-lysine)?
- Oui : Décision – La substance est permise.
- Non : Décision – La substance est interdite.
- Étape 7. La substance est-elle produite (en totalité ou en partie) par fermentation?
- Si Oui allez à l'étape 8.
- Si Non allez à l'étape 10.
- Étape 8. Les hydrates de carbone du substrat/milieu de croissance de fermentation sont-ils issus du génie génétique?
- Si Oui allez à l'étape 9.
- Si Non allez à l'étape 10.
- Étape 9. Existe-t-il sur le marché un substrat non issu du génie génétique? (LSP, 4.1.3, 5.1.2 et 6.2.1)
- Oui : Décision – La substance est interdite.
- Si Non allez à l'étape 10.
- Étape 10. La substance rencontre-t-elle les restrictions relatives à l’origine (par exemple, dérivée de sources spécifiques) et à l’utilisation décrites dans le tableau approprié des LSP?
- Si Oui allez à l'étape 11.
- Non : Décision – La substance est interdite.
- Étape 11. Si une substance contient le substrat ou le milieu de croissance, sont-ils répertoriés dans le tableau approprié?
- Oui : Décision – La substance est permise.
- Non : Décision – La substance est interdite.
Annexe C (informative) Notes sur les principes biologiques
La section 0.2 de l'Introduction décrit les Principes généraux de la production biologique. Ces principes sont ceux d'IFOAM Organics International (disponible en anglais seulement)
Principes de la production biologique dans l’histoire
Les principes énumérés ci-dessous étaient les principes initiaux publiés en 2006. Bien qu’ils aient été mis à jour dans l’introduction de la présente norme, ils ont été conservés dans cette annexe pour donner un contexte aux plans biologiques existants.
La production biologique est basée sur des principes qui prônent de saines pratiques de production. Ces principes ont pour but d’accroître la qualité et la durabilité de l’environnement par le biais de méthodes spécifiques de gestion et de production. Ils permettent également d’assurer le traitement sans cruauté des animaux.
Les principes généraux de la production biologique sont les suivants :
- Protéger l’environnement, réduire au minimum la dégradation et l’érosion du sol, réduire la pollution, optimiser la productivité biologique et promouvoir un bon état de santé;
- Maintenir la fertilité du sol à long terme en favorisant les conditions propices à son activité biologique;
- Maintenir la diversité biologique à l’intérieur de l’écosystème;
- Recycler les matériaux et les ressources le plus possible à l’intérieur de l’exploitation;
- Soigner adéquatement les animaux d’élevage de façon à promouvoir leur santé et à répondre à leurs besoins comportementaux;
- Préparer les produits biologiques, en étant notamment attentif aux méthodes de transformation et de manipulation, afin de maintenir l’intégrité biologique et les qualités essentielles du produit à tous les stades de la production;
- S’appuyer sur des ressources renouvelables dans des systèmes agricoles organisés localement.
Équité
Lors des derniers travaux de révision des normes canadienne sur l'agriculture biologique, les exigences relatives à l'équité ont suscité un vif intérêt. Cette question sera à nouveau abordée en 2025.
IFOAM Organic International a décrit l'équité comme suit :
L'agriculture biologique doit s'appuyer sur des relations qui garantissent l'équité en ce qui concerne l'environnement commun et les opportunités de vie.
L'équité se caractérise par l'équité, le respect, la justice et l'intendance du monde partagé, tant entre les peuples que dans leurs relations avec les autres êtres vivants.
Ce principe met l'accent sur le fait que les personnes impliquées dans l'agriculture biologique doivent entretenir des relations humaines équitables à tous les niveaux et envers toutes les parties – agriculteurs, travailleurs, transformateurs, distributeurs, commerçants et consommateurs. L'agriculture biologique doit offrir une bonne qualité de vie à toutes les personnes concernées et contribuer à la souveraineté alimentaire et à la réduction de la pauvreté. Elle vise à produire un approvisionnement suffisant en aliments et autres produits de bonne qualité.
Ce principe insiste sur le fait que les animaux doivent bénéficier de conditions et d'opportunités de vie qui correspondent à leur physiologie, leur comportement naturel et leur bien-être.
Les ressources naturelles et environnementales qui sont utilisées pour la production et la consommation devraient être gérées de manière socialement et écologiquement juste et devraient être détenues en fiducie pour les générations futures. L'équité exige des systèmes de production, de distribution et de commerce ouverts et équitables qui tiennent compte des coûts environnementaux et sociaux réelsNote de bas de page 5.
Bibliographie
- [1] Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), Accord d’équivalence relatif aux produits biologiques. Disponible à l’adresse Ententes d'équivalence relatifs aux produits biologiques avec d'autres pays.
- [2] Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), Règlement sur les produits biologiques (2009) (DORS/2009-176). Disponible auprès de l’ACIA à Agence canadienne d'inspection des aliments ou sur le site Web de la législation (Justice) à Site Web de la législation (Justice).
- [3] Certified Organic Associations of British Columbia (COABC), British Columbia Certified Organic Production Operation Policies and Management Standards, décembre 2009. Disponible à l’adresse Certified Organic Associations of British Columbia.
- [4] Commission du Codex Alimentarius, CAC/GL 20-1995 – Principes applicables à l'inspection et à la certification des importations et des exportations alimentaires. Disponible à l’adresse Commission du Codex Alimentarius.
- [5] Commission du Codex Alimentarius, CAC/GL 32-1999 – Directives concernant la production, la transformation, l'étiquetage et la commercialisation des aliments issus de l'agriculture biologique. Disponible à l’adresse Commission du Codex Alimentarius.
- [6] Conseil des appellations réservées et des termes valorisants (CARTV), Cahier des charges pour l’appellation biologique au Québec, janvier 2015. Disponible à l’adresse Conseil des appellations réservées et des termes valorisants.
- [7] Santé Canada (HC), Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, ch. 28). Disponible à l’adresse Ministère de la Justice.
- [8] IFOAM Organics International, IFOAM Norms for Organic Production and Processing, août 2014. Disponible à l’adresse IFOAM Norms for Organic Production and Processing (PDF, 1.12Mo) (disponible en anglais seulement).
- [9] Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, Section 3 : Dégradation et accumulation. Disponible à l’adresse OECDilibrary (disponible en anglais seulement).
- [10] Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA). Disponible à l’adresse Pesticides et lutte antiparasitaire.
- [11] U.S. Department of Agriculture, Agricultural Marketing Service, National Organic Program. Disponible à l’adresse Agricultural Marketing Service, National Organic Program (disponible en anglais seulement).
- Date de modification :